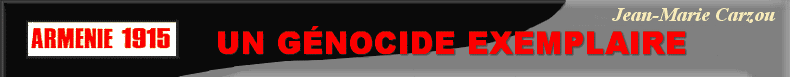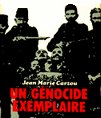Il y a aussi des camps. Les consuls allemands l'indiquent eux-mêmes et les nomment très exactement : Konzentrationslagern, c'est-à-dire camps de concentration. Deux résidentes étrangères ont pu en « visiter » dans la région de l'Amanus :
« Je rentre à l'instant d'une excursion à cheval à travers la plaine de Baghtché-Osmanié, où des milliers de déportés se trouvent sur la plaine et sur la route, sans aucun abri et complètement à la merci de tous les brigands. La nuit dernière vers minuit un petit camp fut brusquement attaqué. Il s'y trouvait de cinquante à soixante personnes. J'y ai trouvé des femmes grièvement blessées. Des corps ouverts, tailladés, des crânes brisés, de terribles blessures de couteau. Heureusement, j'étais pourvue de vêtements de sorte que je pus leur faire changer leurs habits tachés de sang et les emmener dans l'auberge voisine où l'on prit soin d'eux. Beaucoup d'entre eux étaient tellement épuisés par d'énormes pertes de sang, que je crains fort qu'ils ne soient morts depuis. Nous trouvâmes dans un autre camp de 30 à 40 000 Arméniens. J'ai pu leur distribuer du pain. Désespérés et à moitié morts de faim, ils se précipitèrent dessus. Je fus presque jetée à bas de mon cheval, à plusieurs reprises. De nombreux corps gisaient sans sépulture, et ce n'était qu'en payant les gendarmes que nous pouvions les décider à permettre qu'on les enterre. En général, on ne permet même pas aux Arméniens de remplir leurs derniers devoirs envers leurs parents. De terribles épidémies de fièvre typhoïde ont éclaté partout. Il y avait un malade dans une tente sur trois. Presque tout devait être transporté à pied ; hommes, femmes, enfants devaient porter sur le dos le peu qu'ils avaient. J'en ai vu beaucoup tomber d'épuisement sous leur charge, mais les soldats les obligeaient à continuer leur marche à coups de crosses de fusil et parfois même à coups de baïonnette. J'ai eu à panser des blessures saignantes sur des corps de femmes qui avaient été faites par les coups de baïonnette. Beaucoup d'enfants avaient perdu leurs parents et étaient maintenant sans appui. A trois heures d'Osmanié, il y avait deux hommes mourants, absolument abandonnés dans les champs. Ils y étaient depuis plusieurs jours sans nourriture et même sans une goutte d'eau. Leurs compagnons avaient dû poursuivre leur marche. Ils étaient devenus de véritables squelettes, et rien qu'une lourde respiration montrait qu'il restait encore quelque vie en eux. Des femmes et des enfants sans sépulture étaient jetés dans les fossés. Les fonctionnaires turcs d'Osmanié étaient très obligeants ; j'ai réussi à obtenir d'eux plusieurs concessions et parfois les rigueurs furent atténuées. J'obtins des voitures pour ramasser des mourants et les ramener à la ville. »
« Nous vîmes des milliers de petites tentes basses, fabriquées avec des matières très minces. Des foules innombrables de personnes de tout âge et de toutes les classes de la société ; elles nous regardaient moitié avec surprise, moitié avec l'indifférence du désespoir. Un groupe de femmes et d'enfants affamés nous suivaient en nous suppliant : "Hanoum (Madame), du pain! Hanoum, j'ai faim! nous n'avons rien eu à manger ni aujourd'hui, ni hier."
« Vous n'aviez qu'à regarder leurs figures voraces et pâles portant toutes les marques de la souffrance pour voir que ce qu'ils disaient était vrai. Nous pûmes nous procurer 1 800 pains environ. Ils tombèrent tous dessus. Les prêtres qui étaient chargés de la distribution du pain eurent presque à défendre leur vie. Mais ce pain était loin de suffire et on ne pouvait pas en trouver d'autre. Une foule d'affamés était devant nous, nous implorant. La gendarmerie dut les maintenir par la force. Soudain l'ordre du départ fut donné. Si quelqu’un se montrait trop lent à plier sa tente, on la déchirait à coups de baïonnette. Trois chars et un certain nombre de chameaux étaient tenus prêts. Quelques personnes aisées louèrent immédiatement les voitures, tandis que les autres, moins fortunées, chargeaient leurs bagages sur les chameaux. Les gémissements des pauvres, des vieillards et des malades remplissaient les airs : "Nous ne pourrons pas aller plus loin, laissez-nous mourir ici!" Mais il fallait aller plus loin. Nous pûmes du moins payer la location d'un chameau pour quelques-uns d'entre eux et donner un peu de monnaie aux autres pour qu'ils puissent acheter du pain à la station suivante. Des vêtements tissés à la station de la mission d'Adana leur furent distribués par nous. Bientôt après l'immense caravane se mettait en marche. Quelques-uns des plus misérables furent laissés derrière (d'autres reposaient déjà dans les tombes nouvellement creusées). On assure que deux cents d'entre eux, vieillards, malades épuisés, y restèrent attendant un secours. La misère était centuplée par les fortes pluies et le froid qui avaient commencé à sévir. Partout les convois laissèrent en arrière des mourants sur les chemins, des enfants ou des infirmes. En outre, l'épidémie s'étendait de plus en plus. »
« Il avait plu pendant trois jours et trois nuits ; même dans nos maisons nous sentions vivement le froid et l'humidité. Je me suis mis en route aussi vite que possible. Environ deux cents familles avaient été laissées en route à Kharpout. Elles étaient incapables de poursuivre leur voyage par suite d'épuisement et de maladies. Sous cette pluie même les soldats ne se sentirent pas disposés à les relever et à leur faire continuer leur route. De sorte qu'elles étaient gisantes dans ce qu'on aurait pu appeler un lac. Il n'y avait pas un fil de sec dans leur literie en lambeaux. Beaucoup de femmes avaient les pieds gelés, complètement noirs, au point de nécessiter une amputation. Les plaintes et les gémissements étaient horribles. Il y avait partout des mourants en agonie ou des cadavres gisant devant les tentes. Ce n'est que par un « Bakchiche » qu'on pouvait décider les soldats à les enterrer. Ce fut un bonheur pour eux de nous voir leur apporter des vêtements secs. Ils purent se changer et obtenir un peu de pain et même de la monnaie. Je parcourus ensuite, en voiture, toute la route d'Islahiye. Quoique j'eusse vu beaucoup de misère avant, les scènes que j'ai vues là défient toute description. Une femme frêle était assise à côté du chemin, avec ses effets de literie sur son dos et un petit enfant perché sur le sommet de sa charge ; elle tenait dans ses bras un bébé de deux ans, dont les yeux étaient troubles et il était à son dernier soupir. La femme s'était affaissée dans sa détresse et elle pleurait à fendre l'âme. Je l'emmenai avec moi jusqu'au camp suivant où l'enfant mourut. Alors je la soignai et je la remis sur son chemin. Elle me fut si reconnaissante. Ma voiture était remplie de pain.
« Je continuai à en distribuer tout le temps. Nous eûmes trois ou quatre occasions d'en acheter de nouvelles provisions. Ces milliers nous furent d'un grand secours. Je pus aussi louer quelques centaines de bêtes pour aider au transport des malheureux. Le camp d'Islahiye même est la chose la plus triste que j'aie jamais vue. A l'entrée du camp, se trouve un tas de cadavres non enterrés. J'en comptai trente-cinq et à un autre endroit vingt-deux. Dans le voisinage immédiat des tentes de ceux atteints d'une dysenterie virulente, où la saleté dans et tout autour de ces tentes était quelque chose d'indescriptible. Le comité d'enterrement ensevelit 580 corps en un seul jour. Les hommes se battaient pour du pain comme des loups affamés. On voyait des scènes hideuses31. »
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978