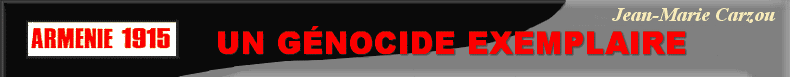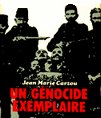« A Deir-es-Zor, grande ville dans le désert, à la distance de six jours de voyage d'Alep, nous trouvâmes le grand khan tout rempli. Toutes les places disponibles, les toits et les vérandas étaient occupés par des Arméniens. Des femmes et des enfants surtout, mais aussi un certain nombre d'hommes se blottissaient sur leurs couvertures, partout où ils pouvaient trouver un peu d'ombre. Aussitôt que j'appris que c'étaient des Arméniens, j'avançai pour leur parler. C'étaient les gens de Fournouz, de la région de Zeitoun et de Marach qui, parqués là, sur une place si restreinte, offraient un spectacle extrêmement triste. Je demandai des nouvelles des enfants de nos orphelinats et on m'amena une élève de Sœur Béatrice Rohner, Martha Karakascian. Elle me raconta ce qui suit : un jour, des gendarmes turcs étaient venus à Fournouz, avaient arrêté un grand nombre d'hommes et les avaient emmenés pour en faire des soldats. Ni eux, ni leurs familles ne savaient où on les menait. On fit savoir au reste de la population qu'ils avaient quatre heures pour quitter leurs maisons. On leur permettait d'emporter tout ce qu'ils pouvaient porter et même d'emmener des bêtes de somme. Dans le délai voulu, les pauvres gens durent sortir de leur village, ne sachant où ils allaient, ni s'ils le reverraient jamais. Au début, tant qu'ils furent sur leurs montagnes, et qu'ils eurent des vivres, tout alla bien. On leur avait promis de l'argent et du pain et on leur donna dans les premiers temps, autant que je me souviens, 30 paras (0,007 livre turque) par tête. Mais très vite ces rations cessèrent et on leur donna seulement du boulgour (froment séché), 50 drames (150 g) par jour et par tête. C'est ainsi qu'après quatre semaines de voyage pénible, les gens de Fournouz étaient arrivés à Deir-es-Zor, par Marach et Alep. Depuis trois semaines ils étaient parqués dans le khan, sans savoir ce qu'on ferait d'eux. Ils n'avaient plus d'argent et les vivres donnés par les Turcs étaient devenus plus rares. Déjà, depuis des jours, entiers, on ne leur avait plus donné de pain. Dans les villes, on les avait enfermés de nuit, sans leur permettre de parler avec les habitants. Ainsi, Martha n'avait pas pu aller à l'orphelinat à Marach. Elle me racontait toute triste : "Nous avions deux maisons, nous dûmes tout laisser ; à présent ce sont des Mouhadjirs (Mahométans émigrés d'Europe) qui habitent là-dedans." Il n'y avait pas eu de massacre à Fournouz et les zaptiés avaient bien traitésles gens. Ils avaient souffert surtout du manque de nourriture et d'eau, dans leur marche à travers le désert brûlant. Comme Yaïladji (montagnards) — titre qu'ils se donnent — ils avaient souffert doublement de la chaleur.
« Les Arméniens affirment ignorer le motif de leur déportation. Le lendemain, à l'heure du repos de midi, nous rencontrâmes tout un campement d'Arméniens. Les pauvres gens s'étaient fait, à la façon des Kurdes, des tentes en poil de chèvre et s'y reposaient. Mais, pour la plupart, ils restaient sans abri sur le sable brûlant et sous les feux du soleil. A cause des nombreux malades, les Turcs avaient accordé un jour de repos. On ne peut s'imaginer quelque chose de plus désolé que de pareilles foules dans ce désert et dans ces conditions. A leurs vêtements, on reconnaissait que ces malheureux avaient vécu dans un certain bien-être ; à présent, la misère était écrite sur leurs visages. "Du pain! du pain!" C'était là leur unique prière. Ils étaient de Guében : on les avait expulsés avec leur pasteur. Celui-ci me raconta qu'il en mourait cinq ou six par jour, enfants ou adultes. Ce jour-là, on venait d'enterrer la mère d'une jeune fille de neuf ans, restée maintenant toute seule. On me pria instamment d'emmener avec moi l'enfant à l'orphelinat. Le pasteur me raconta la même histoire que la petite fille à Deir-es-Zor.
« Ceux qui ne connaissent pas le désert, ne peuvent se faire une idée approximative de la misère et des souffrances des déportés arméniens. Le désert est montagneux, mais le plus souvent sans ombre. Le chemin serpente, pendant des journées entières, sur des rochers et il est très pénible. Quand on vient d'Alep, on a toujours, à sa gauche, l'Euphrate, qui se prolonge comme une bande de terre glaise jaunâtre, mais pas assez près cependant pour pouvoir y puiser de l'eau. La soif qui torture ces pauvres hommes doit être insupportable. Quoi d'étonnant si plusieurs. — si un grand nombre — tombent malades et meurent!
« Un sac de pain aussi dur que la pierre, apporté de Bagdad, fut accepté avec une grande reconnaissance : "Nous le tremperons dans l'eau et nos enfants le mangeront", disaient les mères tout heureuses.
« Le soir, arrivés au village, nous trouvons un autre campement d'Arméniens. Cette fois, c'étaient les gens de Zeitoun. C'était la même misère et la même plainte au sujet de la chaleur, du manque de pain et des vexations des Arabes. Une jeune fille, élevée à l'orphelinat de Beyrouth par les Diaconesses, nous racontait, en bon allemand, ce qu'ils avaient souffert. "Pourquoi Dieu permet-il tout cela ? Pourquoi devons-nous souffrir ainsi ? Pourquoi ne nous tue-t-on pas tout de suite ? Durant le jour, nous n'avons pas d'eau pour les enfants et ils crient de soif. De nuit, les Arabes viennent nous voler nos lits et nos vêtements. On nous a enlevé des jeunes filles et violé des femmes. Si nous ne pouvons plus marcher, les gendarmes nous battent." Ils racontaient aussi que des femmes s'étaient jetées à l'eau pour échapper à la honte ; que des mères ont fait de même avec leurs enfants nouveau-nés, car elles ne voyaient pas d'issue à leur misère. Les vivres manquèrent durant tout le voyage dans le désert. Une mort rapide, avec toute leur famille, apparaît aux mères plus souhaitable que de voir mourir les leurs et de mourir elles-mêmes par la faim. Le second jour après Alep, dans les montagnes de l'Amanus, nous rencontrâmes encore des Arméniens : cette fois, c'étaient les gens de Hadjin et des environs. Ils étaient partis depuis neuf jours seulement. En comparaison de ceux qui se trouvaient au désert, il vivaient encore dans des conditions brillantes ; ils avaient des voitures avec des meubles, des chevaux avec des poulains, des bœufs et des vaches, et même des chameaux. Le convoi était interminable : il gravissait la montagne ; et je me demandais combien de temps ils garderaient encore leurs biens. Ils étaient encore sur le sol natal, en montagne, et n'avaient aucun pressentiment des terreurs du désert. Ce furent les derniers Arméniens que je vis. On ne peut oublier de tels événements37. »
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978