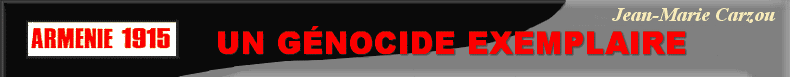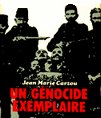« Des milliers de jeunes gens, Turcs, Grecs, Arméniens, Bulgares, etc., forment aujourd'hui, dans l'Empire ottoman, une élite intellectuelle et morale dont il devient de plus en plus difficile au Sultan de comprimer les aspirations vers la science et la liberté. Les persécutions dont cette élite est l'objet ont, elles-mêmes, puissamment contribué à développer et à étendre son influence. Les libéraux de Constantinople qu'Abdul Hamid a exilés dans les divers points des provinces y ont introduit leurs habitudes de critique des actes de l'autocratie et leur tempérament de révoltés. Sous leur impulsion, l'Arménie est aujourd'hui presque tout entière en insurrection contre le Sultan. On chasse les fonctionnaires des villes ; on entraîne les soldats et les officiers eux-mêmes dans la rébellion ; on y réclame à grands cris la Constitution qu'Abdul Hamid croyait avoir enterrée dans le cimetière de Taïf avec le cadavre décapité de Midhat ; et, déjà, les grandes lignes de la Constitution que sollicite le peuple sont tracées par les fils de ceux qui préparèrent celle de 187621. » Ces lignes destinées à la préface d'une biographie de Midhat par son fils datent de mai 1908 ; et, dans leur exagération même, elles témoignent de l'effervescence qui règne durant les derniers mois de l'autocratie.
Coupé de la réalité dans son palais de Yldiz-Kiosk, Abdul Hamid n'a pas pris conscience des graves menaces que font inéluctablement peser à terme sur son pouvoir la dégradation administrative et économique de l'Empire, l'accroissement de la présence et des exigences étrangères, le mécontentement d'une opposition certes bannie et peu nombreuse mais dont l'écho grandit en Turquie même, en particulier parmi les militaires de tous grades. Les participants du Congrès des partis d'opposition s'étaient donné, à Paris, en décembre 1907, dix-huit mois pour être à Constantinople. Sept mois vont suffire, même s'il en faudra encore neuf pour aboutir à l'abdication du Sultan. Car c'est une révolution en deux temps qui s'engage en juillet 1908. Elle commence par un putsch militaire à Salonique : réunis autour de Enver et de Niazi, qui s'est illustré dans la guerre contre la Grèce, quelques officiers se sont en effet lancés dans l'aventure d'une conspiration. Ces officiers sont nationalistes, et il s'agit pour eux de sauver l'Empire : puisque Abdul Hamid paraît incapable de résister à la pression étrangère que la récente rencontre de Nicolas II et d'Edouard VII rend plus menaçante, ils prendront le relais. Inertie du Sultan aveuglé, faiblesse de la résistance militaire loyaliste, chance ou résolution des mutins, toujours est-il que l'opération réussit : Enver et Niazi lancent un appel à l'armée et au pays pour demander le rétablissement de la Constitution de 1876 ; en deux semaines le mouvement s'amplifie et Abdul Hamid se trouve devant la menace d'une guerre civile en Macédoine. Dans l'armée, les défections se multiplient. Il se voit isolé et cède donc : le 24 juillet, il fait proclamer le rétablissement de la Constitution.
Cette première victoire dont le seul but est d'imposer au Sultan un gouvernement national capable de sauver l'Empire ramène en même temps à Constantinople tous ceux qui, de leur exil à Paris ou Genève, ont engagé la lutte pour le renouveau de la Turquie : intellectuels et hommes politiques turcs (avec, à leur tête, Ahmed Riza, grand admirateur d'Auguste Comte), révolutionnaires arméniens, etc., tous ceux qu'a réunis le Congrès de 1907 et qui, avant même cette date, avaient commencé d'unir leurs efforts. Et c'est dans le droit fil de cette unanimité que, lorsqu'il apparaît que le Sultan a cédé aux exigences des rebelles, la réussite du putsch s'accompagne d'une stupéfiante et exaltante fraternisation de toutes les couches sociales et de toutes les populations. A Constantinople, l'explosion de joie qui fait descendre les habitants dans les rues entraîne d'innombrables scènes où l'on voit Turcs et Arméniens, musulmans et chrétiens, se mêler pour applaudir aux premiers pas du nouveau régime. Les haines, les craintes, les heurts si souvent sanglants et horribles, tout est oublié dans cette aurore d'une Turquie nouvelle et réconciliée.
Tout paraît ainsi avoir en quelques jours brusquement changé. La Constitution de 1876, objectif essentiel des officiers rebelles, est enfin appliquée et du même coup son inspirateur Midhat réhabilité trente ans après. Abdul Hamid renonce à ses espions, change de ministres, accepte la convocation du Parlement le 17 décembre et se rend à la première et solennelle séance de cette Assemblée qui symbolise, malgré la précipitation avec laquelle elle a été convoquée, le renouveau d'une politique libérale en même temps que la régénération de l'Empire. Tout manifeste ainsi dans ces premiers mois, avec l'instauration sérieuse d'un régime constitutionnel et libéral à l'occidentale, la réinsertion des chrétiens dans la communauté nationale. C'est la fin du cauchemar.
Au sein du groupe qui a déclenché la révolution, certains auraient voulu obtenir immédiatement l'abdication d'Abdul Hamid : ils craignent en effet une contre-révolution. Et les événements vont leur donner raison : en avril 1909, après un hiver difficile (ambiguïté des réformes politiques, problèmes économiques, affrontements avec les grandes puissances qui renouvellent partout leur pression), Abdul Hamid engage une action par laquelle il entend annuler tout ce qu'on l'a forcé d'accepter. Et peut-être la grande vague de violence populaire et religieuse qui déferle alors sur l'Empire est-elle plus spontanée, le simple effet d'une allergie traditionaliste à un bouleversement qui est dans son essence laïque, athée, moderniste et égalitaire. Toujours est-il que, durant quinze jours, les manifestations s'enchaînent partout, multiples, violentes, et que, derrière le fanatisme médiéval d'une réaction islamisante, c'est d'une véritable contre-révolution qu'il s'agit, probablement animée par l'Association mahométane qui rassemble depuis quelques mois en secret tous ceux que la tournure prise par les événements a heurtés et mécontentés. Eût-elle abouti qu'Abdul Hamid retrouvait intact le pouvoir despotique qu'il s'était assuré sur l'Empire. Les nouveaux gouvernants passent alors un moment difficile et ils sont visés tout autant que les chrétiens. L'élite arménienne ne semble pas d'ailleurs les tenir pour responsables de ce sursaut réactionnaire, puisqu'elle continue de les soutenir, allant jusqu'à cacher certains d'entre eux pendant les jours les plus critiques. Et quand l'émeute permet à Abdul Hamid d'imposer la démission des Jeunes Turcs et de remettre en place un ministère loyaliste, le comité Daschnaktsoutioun s'associe, avec les autres comités nationaux, aux comités ottomans (qui font alors taire leurs divisions entre « jeunes turcs » alors considérés comme plus nationalistes et « libéraux ») pour boycotter les séances du Parlement et lancer un appel à « l'union ottomane ». Enfin, les troupes de Macédoine arrivent à Constantinople et la tentative de contre-révolution échoue : Abdul Hamid est destitué, son frère cadet lui succède et la révolution jeune turque triomphe définitivement.
Mais la violence s'est encore une fois exercée de façon prépondérante à l'égard des chrétiens et les Arméniens eux-mêmes sont victimes d'un nouveau et vrai massacre à Adana. Il apparaît là clairement que les vieux antagonismes de race et de religion n'ont pas disparu du jour au lendemain, dissipés dans la fraternisation de la nouvelle Turquie, et il y a pour le moins clivage entre ce qui reste pour le moment le credo égalitaire et constitutionnaliste du nouveau gouvernement (unir chrétiens et musulmans) et les pulsions fondamentales qui continuent d'agiter la masse populaire.
Les choses ont été en effet horriblement nettes : c'est probablement 20 000 morts qui s'accumulent en quinze jours dans les rues de la ville et sur l'ensemble du vilayet, à Sis, à Tarsous, ailleurs encore. Un officier russe témoigne aussitôt de ce qu'il a vu à Adana même : « La vision des quartiers détruits ne supporte pas la description : les trois quarts de la ville n'existent plus, sont intacts seulement les quartiers musulmans. Le long du fleuve Sihoun, le reste de la ville (5 à 6 000 maisons) ressemble à un amoncellement de gravats ; çà et là des murs brûlés aux fenêtres arrachées, les plafonds et les sols se confondent. Dans cette partie de la ville règne un silence de mort, on ne voit que des chats affamés, des chiens ou des corbeaux, parfois un malheureux Arménien cherche dans les ruines de sa maison les restes de ce qu'il possède24... »
En 1907 déjà, les Arméniens avaient dû protester énergiquement contre une tentative de « complot » montée contre eux par les autorités locales pour servir de prétexte au déclenchement du massacre. Il a lieu finalement le 14 avril, au lendemain de l'émeute anticonstitutionnelle de Constantinople ; il dure toute la semaine, reprend encore le 25 et les jours suivants — et c'est le tableau habituel : assassinats, viols, pillages, incendies, participation de la troupe et d'une partie des autorités officielles comme en témoigne un rapport de l'ambassade russe : « ... les troupes turques qui se trouvent à Adana et les notables musulmans du lieu ne cessent d'entretenir des rapports haineux avec les chrétiens. L'état de siège, institué dans cette ville, concerne principalement les chrétiens. Les pouvoirs locaux manifestent une certaine indulgence à l'égard des coupables des massacres des chrétiens et s'efforcent d'en faire retomber la responsabilité sur ces derniers24... » .
Le ministre français des Affaires étrangères le confirmera à Paris devant la Chambre des députés : « Il est arrivé malheureusement que des troupes qui avaient été envoyées pour prévenir et réprimer les attentats y ont, au contraire, participé. Le fait est exact1. » Et, quand le déchaînement fanatique s'apaise provisoirement, tout continue de ressembler à ce que nous connaissons : personne n'est puni, et l'on fait passer en jugement quelques Arméniens présentés comme « rebelles » ; bien que ce soit un des chefs jeunes turcs, Talaat, qui préside le comité qui répartit les secours rassemblés en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis (car l'opinion publique, dans le monde, s'est violemment émue devant le renouvellement d'atrocités que l'on croyait à jamais disparues avec l'ancien régime), des dizaines de milliers de personnes restent exposées à la famine et à la misère, ayant perdu tous leurs biens ; enfin, il est encore une fois impossible de connaître avec exactitude le nombre des victimes. Un fait est à cet égard tout à fait significatif : la Chambre ottomane, après avoir vu dans les Arméniens les agresseurs (puisque les premières dépêches officielles signalent que les victimes sont en majorité musulmanes), décide en juin de confier une enquête sur les événements à deux de ses membres : un Arménien, Babikian, et un Turc, Youssouf Kemal ; au début d'août ils rentrent à Constantinople avec des statistiques totalement divergentes : 620 morts musulmans pour Babikian et 1 197 pour Kemal ; 18 660 Arméniens pour Babikian et 5 153 pour Kemal. Babikian meurt deux jours après, et les rapports sont enterrés.
En tout état de cause, la responsabilité turque est à l'évidence engagée et tous les témoignages étrangers en font foi ; mais les hommes politiques arméniens hésitent à croire que leurs collègues jeunes turcs du gouvernement ont trempé dans l'affaire et, bien qu'ils sachent n'avoir plus le choix qu'entre «le massacre ou la Russie27», ne veulent entendre que les éloges qu'Enver et Chevket décernent, lors de l'enterrement des soldats qui ont payé de leur vie la reprise de Constantinople en avril, à la fraternité agissante des musulmans, des chrétiens et des juifs. Légalistes jusqu'au bout, les dirigeants arméniens acceptent la thèse de l'accident et poursuivent le jeu parlementaire ; ils sont d'ailleurs membres de plusieurs des organismes du nouveau système, députés, ministres, etc. Et c'est ainsi qu'ils exprimeront au Parlement, dans les journaux, pas autrement, leur préoccupation devant la dégradation de la situation de leurs compatriotes. Ils portent cependant un jugement lucide sur « la Turquie nouvelle », comme en fait foi le rapport présenté en 1910 au Congrès socialiste international de Copenhague par le parti Daschnak : « Inutile de le dire, ce parlementarisme ottoman laisse beaucoup à désirer. C'est la prédominance de l'élément turc, c'est presque la dictature d'un Comité. Certes, le régime actuel est toujours une délivrance, après l'enfer hamidien ; un grand souffle de liberté passe sur ces régions ténébreuses, où naguère le sang coulait à flots. Mais au point de vue de la réforme fondamentale, l'œuvre de ce nouveau régime est pour l'instant insignifiante. Les nationalités non turques ne sont reconnues par la loi que comme des « communautés religieuses ». »
Il apparaît pourtant de plus en plus nettement que la fraternisation n'aura été qu'un feu de paille, une illusion encore. Et ce ne sont pas les signaux d'alarme qui manquent. Par-delà toutes les manifestations où s'unissent les diverses communautés, il y a d'abord le fait que le pouvoir réel est tout entier concentré entre les mains de ce petit groupe qui a pris de Salonique la direction des opérations. Ils sont maintenant à Constantinople et l'équipe qu'ils forment a sa propre existence en dehors des partis et du gouvernement : c'est le « Comité », dénomination simplifiée à partir du nom que s'étaient donné en commun les deux groupes de Paris et de Salonique de « Comité Union et Progrès ». Elle servira bien vite à indiquer dans sa brièveté allusive la toute-puissance d'une équipe dont on ne connaît pas bien la liste, qui n'a pas de chef avoué et qui se réunit toujours en secret avant d'imposer ses vues. Qui sont-ils ? Officiers ou politiques, ils sont turcs à 95 %, et il n'y a parmi eux, dans ce groupe qui contrôle toutes les décisions, qu'un ou deux non-Turcs, qui sont juifs (Djavid bey). Cette proportion correspond d'ailleurs à celle que l'on trouve au Parlement : 216 musulmans sur 262 députés (et 10 Arméniens).
Parmi les membres de ce Comité, et principalement chez les officiers, se fait jour dès à présent une tendance ultra-nationaliste qui déborde largement les premiers objectifs officiels de la révolution. Pour eux, il s'agira essentiellement de « turquifier » l'ensemble de la population et des institutions ; retrouvant ainsi les motivations de la politique tsariste, ils croient que le salut de l'Empire ne peut passer que par cette unification de tous les caractères de l'Etat. A cet effet, diverses lois vont accentuer la centralisation du pouvoir, limiter les prérogatives des communautés nationales, interdire même qu'une association porte le nom de l'ethnie qui la crée. L'article 4 de la loi sur les associations votée en août 1909 stipule en effet : « La constitution d'associations politiques sur la base ou sous la dénomination de nationalité est interdite. » Quoiqu'il ne soit point encore question d'élimination physique des minorités allogènes, cette tendance peut inquiéter par son outrance et la détermination qu'elle implique. Visant aussi bien les Arabes que les chrétiens, l'idée du devenir turc de l'Empire sera ainsi développée publiquement au Parlement ; elle nourrit certainement déjà les réunions secrètes du Comité et apparaît clairement lors du congrès qu'il tient en 1910.
Il est vrai que le nouveau gouvernement doit faire face à de nombreux problèmes. Sur le plan économique, il a fallu contracter de nouveaux emprunts, car, malgré l'aide apportée par quelques experts étrangers, la situation est catastrophique ; et il n'est pas question d'arrêter la grande entreprise du chemin de fer de Bagdad, ni de retourner à la banqueroute. Bien que la présence allemande ait été un moment éclipsée pendant les événements de 1908-1909, ce sont des banques allemandes et autrichiennes qui, dès 1910, fournissent l'argent nécessaire. Mais la France reste la puissance qui investit le plus en Turquie et, en 1914 encore, elle signe avec le gouvernement des Jeunes Turcs des accords financiers et économiques. La Russie, l'Angleterre, l'Italie en font autant : la pression européenne n'a rien perdu de sa force.
Et le spectre du partage rôde toujours. Car, sans vouloir attendre la consolidation du nouveau régime, et prouvant par là une fois de plus combien étaient illusoires les beaux discours sur le sort des chrétiens et l'aide à une Turquie régénérée, les grandes puissances ont relancé dès 1908 leur politique d'expansion. C'est d'abord, tout de suite, l'Autriche-Hongrie qui, unilatéralement, et sans consulter personne (sauf l'Allemagne bien évidemment), décide en octobre 1908 d'annexer la Bosnie-Herzégovine, dont le congrès de Berlin lui avait confié l'administration. Bien qu'elle reçoive une indemnité financière à titre de compensation, la Turquie est finalement obligée d'accepter cette décision. Simultanément, la Bulgarie a proclamé son indépendance complète et le prince Ferdinand devient roi. Un peu plus tard, l'Italie se met à son tour sur les rangs : elle n'a pas encore obtenu grand-chose, il lui faut la Libye, alors Tripolitaine ; c'est donc la guerre, une mutilation encore : en octobre 1911, après un ultimatum au gouvernement turc, les Italiens débarquent à Tripoli et à Benghazi et prononcent l'annexion du territoire ; mais, comme la lutte se prolonge du côté du désert, ils ouvrent un autre front directement sur la mer Egée, occupant Rhodes et les îles voisines après avoir bombardé Beyrouth, se présentant devant les Dardanelles. Simultanément les Etats balkaniques déclenchent une guerre contre la Turquie, profitant de ses difficultés avec l'Italie pour tenter de lui ôter enfin ses dernières possessions d'Europe.
En octobre 1912, la Turquie se trouve donc prise entre deux feux, obligée de céder à l'Italie, en même temps qu'elle doit subir une guerre où, face à la Serbie, à la Bulgarie, au Monténégro et à la Grèce, elle va d'abord tout perdre à la suite de défaites militaires que l'on n'attendait pas ; mais les vainqueurs ne sont pas satisfaits des préliminaires de paix de mai 1913 et rentrent en conflit entre eux. Au traité définitif d'août à Bucarest, les Turcs auront pu au moins sauver Andrinople, courte tête de pont qui leur reste seule du côté de l'Europe où ils ont dû abandonner l'Albanie et la Macédoine, et la Crète aussi. Dans ce sursaut qui leur a permis en définitive d'annuler une partie de l'effet de leurs premières défaites, les Turcs manifestent l'énergie qu'ils vont mettre dorénavant dans la lutte pour la survie. Devant une voracité cynique que rien n'arrête (car, déjà, les Puissances discutent du partage de la Turquie d'Asie), comment les nouveaux dirigeants turcs, pétris d'un nationalisme ardent, ne se verraient-ils pas renforcés dans l'idée que les Turcs seuls pourront sauver la Turquie ? Il ne leur est pas très difficile d'imaginer ce qui va se passer si rien ne fait obstacle à tant d'invasions : il ne reste plus grand-chose à leur enlever — ce dernier îlot en Europe, la Palestine et la Syrie, l'Arménie bien sûr —, et c'en sera fait de la Turquie. C'est-à-dire exactement ce qu'ils ont voulu éviter en prenant le pouvoir.
La consolidation du gouvernement jeune turc après l'échec d'Abdul Hamid ne manque pas non plus d'épisodes révélateurs. Le Comité entend bien, en effet, conserver et accroître l'autorité qu'il s'est acquise lors du putsch ; c'est lui qui détermine les élections, prend les décisions, renverse et nomme les ministres, faisant peser sur le pays entier un pouvoir qui devient peu à peu aussi oppressant que celui de l'ancien Sultan. C'est donc autour de lui que se développent les conflits et les luttes de tendances — en son sein, entre des clans aux ambitions rivales, au-dehors aussi avec la formation de groupes « libéraux » animés par certains de ceux qui ont contribué au renversement d'Abdul Hamid (le prince Sabaheddine, Ahmed Riza et d'autres), dans l'armée enfin où d'autres officiers rêvent eux aussi d'être les chefs suprêmes. Avec une habileté remarquable, les principaux responsables du Comité, qui représentent la tendance la plus dure, turquifiante et pro-allemande, alternent les mesures d'apaisement et les contre-attaques décisives. C'est ainsi qu'au congrès du parti en 1910, ils cherchent à « récupérer » l'opposition en adoptant les mesures qu'elle propose ; et à plusieurs reprises, en particulier en juillet 1912, ils acceptent apparemment de s'écarter...
Mais, simultanément, on assassine les journalistes d'opposition les plus en vue, l'état de siège reste continûment en vigueur (sous prétexte de révoltes que la politique de turquification a suscitées, non seulement en Albanie et en Macédoine, mais aussi au Yémen et en Syrie) et les lois d'inspiration libérale ne sont pas appliquées. Enfin, en janvier 1913, après les premières défaites devant les forces balkaniques et au moment où les Puissances envoient au gouvernement turc une note comminatoire lui enjoignant d'accepter la cession d'Andrinople, le Comité reprend définitivement le pouvoir à la faveur d'un véritable coup d'Etat : Chevket devient grand vizir et Enver (héros de la deuxième guerre balkanique, car c'est lui qui reprend Andrinople), Talaat et Djemal sont tout-puissants. Ils le seront bien davantage après l'assassinat de Chevket en juin, qui fournit le prétexte à une concentration totale des responsabilités de l'Etat entre leurs mains, désormais doublée d'une constante répression contre toutes les formes d'opposition.
A Constantinople même, ils manifestent le désir d'un modernisme de bon aloi : la Turquie nouvelle doit présenter le visage d'un pays libéré de tous ses caractères archaïques. Et il est vrai que, dans son obsession des complots et du modernisme, Abdul Hamid avait empêché sa capitale de bénéficier du téléphone ou de l'éclairage électrique. En quelques années, un gros effort va être fait pour rattraper ce retard ; de plus, on harmonise la définition de l'heure avec le système européen, on modernise la voirie, la protection contre les incendies, les postes. C'est dans le même esprit que le gouvernement décide l'élimination des chiens. La ville de Constantinople était en effet célèbre par le nombre de chiens qui y vivaient auprès des hommes, chiens d'un type spécial « qui participait à la fois du chien d'Occident, du loup et du chacal », véritable population parallèle forte de 60 000 à 80 000 individus. Cette communauté s'était véritablement organisée en bandes précises aux territoires bien définis ; nantie de chefs et de coutumes, elle partage la rue avec les habitants, vivant auprès d'eux, selon leurs habitudes, habile à tirer sa nourriture du vol, des poubelles ou des largesses. Ils sont donc très liés avec les concierges, les portefaix, les Européens aussi parfois, quoique cette race ne fraye jamais avec les chiens « domestiques » de leurs épouses. Ils font partie de la vie quotidienne, mais, au moment de la révolution, ils apparaissent comme le symbole de l'ancien régime, et l'idée vient aux nouveaux dirigeants de montrer, en les faisant disparaître, que Constantinople va devenir enfin une ville moderne à l'occidentale. Mahmoud II le Réformateur avait d'ailleurs déjà tenté une opération du même ordre, mais cette fois la décision est irrévocable. Le docteur Remlinger, alors directeur de l'Institut Pasteur de Constantinople, aurait voulu s'opposer, par affection pour « ces bonnes et braves petites bêtes », à une telle mesure et il le dit lui-même dans un article publié en juillet 1932 dans le Mercure de France auquel nous empruntons le récit de l'événement : « Je compris vite que la décision gouvernementale était irrévocable, qu'essayer de la combattre était s'exposer à d'injurieux soupçons et se compromettre inutilement. Je me demandai par contre s'il n'existait pas, pour décaniser la ville, un moyen plus discret et moins barbare que la déportation dans une île déserte. Avec sa peau, ses poils, ses os, sa graisse, ses muscles, ses matières albuminoïdes en général, son intestin même, la valeur marchande d'un chien de rue était de 3 à 4 francs. Il y avait en ville de 60 000 à 80 000 chiens. Ils représentaient donc un capital de 200 à 300 000 francs. N'était-il pas possible de confier, après adjudication, la décanisation à un concessionnaire qui, en différents points de la banlieue, installerait des clos d'équarrissage économiques ? Ceux-ci comprendraient une chambre hermétique communiquant avec la canalisation du gaz et un atelier de dépeçage comprenant tout ce qui était nécessaire pour le traitement des produits utilisables de l'animal. Les chiens seraient appréhendés la nuit discrètement et transportés à pied d'oeuvre dans des voitures du modèle des fourrières européennes. Dix clos d'équarrissage pourraient chacun traiter par jour une centaine de chiens. En deux mois la décanisation était terminée et l'opération procurait à la ville un bénéfice qui était affecté à des œuvres de bienfaisance. » Mais le gouvernement rejette son rapport au Conseil d'Hygiène et choisit la manière forte traditionnelle. On commence donc par détruire les portées en entassant les chiots dans des sacs que l'on vide en pleine mer. On passe ensuite aux chiens adultes. Accompagnés de soldats et d'agents de police, des auxiliaires irréguliers parcourent les rues pour s'emparer des chiens et les enfermer dans des cages, capture souvent difficile et toujours cruelle. En quinze jours, au milieu des hurlements, tous les chiens sont donc rassemblés et on procède à leur déportation sur un îlot rocheux de la mer de Marmara où on les abandonne sans aucune nourriture : des hurlements bien plus atroces retentissent alors pendant plusieurs semaines, puis le silence revient. Il n'y a plus de chiens à Constantinople.
Durant les six années qui séparent presque jour pour jour le début du génocide du triomphe définitif de la révolution jeune turque, les Arméniens continuent de soutenir loyalement le nouveau régime. Et pourtant ces six années-là passent très lentement. Partout, dans la vie quotidienne des provinces et des villes, tout recommence comme avant. Certes, les chrétiens gardent encore le statut qui vient de les réunir aux musulmans comme d'identiques sujets du Sultan (depuis 1910, ils sont soumis comme eux et avec eux au service militaire), mais rien n'a été entamé en profondeur. « Avec la proclamation de la Constitution, rien n'a fondamentalement changé en Turquie à part le gouvernement central24» : le musulman retrouve ce comportement de mépris et d'abus qu'il n'a jamais extirpé de lui-même, le chrétien, et particulièrement l'Arménien, sa résignation au déroulement injuste des jours.
Le Patriarcat de Constantinople n'a d'ailleurs jamais cessé de protester auprès du gouvernement contre les diverses exactions dont les Arméniens continuent comme avant d'être les victimes. Et année après année, en 1908 même, puis en 1909, 1910, etc... il dresse la liste des meurtres, des rapts, des usurpations de biens. A Erzeroum, en 1912, les diplomates russes constatent : « La situation de ce peuple, au milieu de musulmans haineux et fanatiques, est effectivement très effrayante : à chaque instant ils craignent non seulement pour leurs biens mais aussi pour leur vie, car les bruits qui courent au sujet des pogroms ne cessent jamais24. »
Quoi d'étonnant alors à ce que toutes les autres pièces de l'engrenage se remettent en place ? Puisque les conditions de vie des populations chrétiennes, et particulièrement arméniennes, sont redevenues intolérables, les grandes puissances, à l'instigation cette fois de la Russie, décident en 1913 de remettre sur le chantier la question des réformes dans les provinces arméniennes. Il faut bien sûr plusieurs mois de constante navette entre ambassades et gouvernements pour aboutir à un projet qui, tout en apportant une solution satisfaisante au problème posé, permette en même temps, et c'est bien plus important, de dissiper les soupçons des partenaires européens de la Russie, de vaincre aussi les hésitations de l'Allemagne. Peu désireuse, en un moment crucial pour le succès de sa stratégie globale, de risquer la position qu'elle a conquise à Constantinople en indisposant le gouvernement turc, l'Allemagne saura lui faire valoir qu'elle n'est entrée dans l'affaire que pour protéger ses intérêts ; et, de fait, l'ambassadeur allemand intervient pour faire adopter un texte de compromis assez éloigné des propositions russes initiales. Ce texte prévoit néanmoins un statut particulier pour les six vilayets arméniens (plus celui, voisin, de Trébizonde), annonce des garanties et un contrôle enfin réels ; et comme, au même moment, c'est une véritable délégation arménienne qui s'est constituée à Constantinople même auprès du Patriarcat, il est sûr que les conditions d'un règlement sérieux et réel, non plus formel mais bien destiné à être appliqué, sont pour la première fois réunies.
Les Turcs ont d'abord réagi comme d'habitude et le changement de régime, d'hommes, d'option politique est sans conséquence : devant l'intervention européenne, ils fabriquent leur propre plan de réformes — l'habituel pare-feu, précédé en mars 1913 d'une nouvelle loi sur les vilayets, étendue de plus cette fois à l'ensemble de l'Empire et particulièrement de la Turquie d'Asie ; dans cette relance où se manifeste toujours la « bienveillance » du Sultan apparaît l'évident désir d'éviter qu'un sort particulier soit fait aux Arméniens : en proposant l'extension généralisée des réformes, les Turcs sont non seulement sûrs de vider de sa réalité le projet européen, mais aussi de noyer dans la masse une notion ethnique qui les gêne.
Mais voilà qu'effectivement, rien ne se passe plus comme avant : les Européens ne se contentent pas de la réponse turque, ils insistent et ne cèdent pas sur les caractéristiques essentielles de leur projet : pour l'Arménie, de vraies réformes, un contrôle. Le gouvernement turc se voit donc contraint pour la première fois de signer, en février 1914, un texte d'administration intérieure qui a quelques chances d'être appliqué. Ce texte, que l'on trouvera en annexe, comporte en outre un certain nombre de mesures réellement favorables à l'établissement pour les populations arméniennes de conditions de vie normales : faculté pour les populations d'utiliser leur langue dans l'éducation et la justice, contrôle des régiments hamidié, participation égalitaire des chrétiens et des musulmans aux différents organismes représentatifs (y compris la gendarmerie et la police), contrôle par des inspecteurs généraux étrangers de toute l'administration des vilayets de l'Anatolie orientale. Et, bien que leurs pouvoirs soient encore considérablement rognés par rapport au texte officiel de l'accord, les inspecteurs sont nommés : un Hollandais, Westenenk, et un Norvégien, Hoff ; et ils vont se rendre sur place pour commencer leur travail.
Le consul Anders, lui-même en tournée d'inspection pour le compte de l'ambassade allemande, décrit ce qu'est au même moment la situation des populations arméniennes d'Anatolie : « Le mutessarif était absent lorsque je suis arrivé. Son remplaçant, le procureur général, m'a réservé un accueil des plus chaleureux. Bien qu'il m'ait laissé entendre que la situation générale dans le sandjak de Mouch était calme pour le moment, je changeai bientôt d'avis après la visite de l'archevêque arménien Nersès Garikian et du chef daschnak, Rouben Effendi. Tous deux tiennent le calme actuel pour une accalmie avant la tempête et se sont montrés très pessimistes. A leur avis, si les chefs kurdes sont intimidés par la rigueur de la cour martiale de Bitlis, ce n'est que pour peu de temps : le projet de réformes contrecarre trop leurs intérêts pour qu'ils ne tentent pas d'opposer la plus grande résistance à ces nouvelles dispositions.
« L'archevêque arménien me décrivit très longuement la situation des paysans dans le caza de Modikan. Leur état de dépendance s'est aggravé au point que les Derebeys se vendent mutuellement des villages entiers, avec leurs habitants — comme au temps du servage en Russie décrit par Gogol —, chaque habitant valant en moyenne entre cinq et quinze livres turques*. Les Chegolis, une branche issue des Balliklis, qui possèdent trente villages, ont ainsi récemment acheté à un Derebey le village arménien de Pichenk.
« Lors de l'insurrection des Arméniens de Sassoun en 1894, les paysans arméniens des villages de Tavorik et de Chiankichoub dans la région de Chatakh ont chassé les Kurdes venus prélever les impôts de servage. De même, avec l'aide du gouvernement constitutionnel, vingt-cinq villages se sont libérés en 1908 dans la région de Pzank. Par contre, dans le caza de Modikan règne encore la situation patriarcale d'antan. Les paysans sont tenus de fournir certaines livraisons aux beys. Aussi la misère des serfs arméniens et kurdes doit être effrayante. Le caza entier ne compte qu'une seule école arménienne, dans le village de Chisek. A Chinist, une école arménienne devait s'ouvrir avec le soutien de Boghos Nubar pacha, mais, devant les menaces des Kurdes, les professeurs eurent vite fait de prendre la fuite.
« Il est fait état actuellement d'une plainte des habitants des villages de Chinist, Pachnavank et Lordenzor, à qui les Balliklis réclament respectivement 2 300, 1 500 et 800 livres turques, pour une dette insignifiante contractée soixante ans auparavant par les aïeux des paysans actuels. L'évêque d'ici a fait un rapport au patriarcat, mais le gouvernement nie cet état de fait. Le bureau de presse a également démenti les informations de l'évêque.
« Le mode de recouvrement de l'impôt sur les moutons est très particulier. Peu avant l'apparition des tahsildars (percepteurs), les Kurdes Balliklis ont amené trois cents moutons dans le village arménien de Chuit, et ils ont été pris en compte, malgré les protestations des habitants. Comme les paysans se refusent à payer l'excédent d'impôt, environ vingt livres turques, leurs vaches et leurs bœufs sont vendus de force.
« Si le vol des moutons et les luttes de terrain engendrent ainsi une tension entre Kurdes et Arméniens, l'évêque reconnaît toutefois que les plaintes relatives aux atteintes à l'existence et à l'honneur sont devenues plus rares ces derniers mois. Dernièrement, quatre ou cinq Arméniens seulement ont été assassinés par les Kurdes Bedrik (tribu de Moussi). Dans certains cas d'enlèvements de jeunes filles, il a été impossible d'établir que celles-ci n'avaient pas suivi volontairement leurs ravisseurs. Le chef daschnak Rouben craint des troubles pour bientôt car, jusqu'à présent, chacune des tentatives des grandes puissances visant à mettre sur pied un programme de réformes a été suivie de massacres. Les Kurdes paraissent extrêmement mécontents du gouvernement, qu'ils ne considèrent pas comme étant purement islamique puisqu'il a fait exécuter leur chef religieux Scheich Seyid, qu'ils vénéraient comme un prophète. D'après Rouben, les Derebeys s'apprêtent à défendre énergiquement leurs prérogatives menacées. Rouben se plaint aussi de la grande partialité des tribunaux et de ce que les gendarmes n'exécutent pas les ordres du gouvernement lorsqu'ils sont en faveur des Arméniens et au détriment des Kurdes. Les Kurdes ne respectent nullement les gendarmes, mais seulement les soldats16. »
Mais nous sommes en juillet 1914... Les bruits de guerre accaparent l'attention de l'Europe et les Turcs en tirent rapidement avantage : ils décident unilatéralement l'arrêt du processus de réformes engagé à la suite de l'accord de février et renvoient les deux inspecteurs. Djemal explique ainsi dans ses Mémoires cette décision qui sera officialisée par un décret de décembre : « Prévoyant qu'il lui serait impossible de s'occuper de réformes internes pendant de longues et pénibles années de guerre, le gouvernement ottoman a considéré qu'il n'était pas nécessaire de prolonger le mandat des deux inspecteurs étrangers qu'il avait affectés aux provinces orientales de l'Anatolie. » Mais il ajoute plus loin : « Dans la question de la réforme arménienne nous désirions nous libérer de l'accord que la pression russe nous avait imposé9.» M. Hoff n'aura donc passé que quelques semaines à Van, mais c'est encore trop pour un gouvernement qui a fait de son indépendance nationaliste la seule finalité de tous ses actes. Et il est d'ores et déjà clair que sa réaction à l'égard des Arméniens sera à la mesure d'une intervention européenne qui s'est montrée cette fois résolue.
A Constantinople, les événements d'Europe sont suivis avec une extrême attention, car l'on se doute bien que, dans cette guerre mondiale, le secteur d'Asie jouera lui aussi un rôle déterminant : et le pétrole de Bakou, la navigation dans les Détroits, le contrôle du Moyen-Orient, du golfe Persique au canal de Suez, donnent à l'alliance turque une importance nouvelle. Aussi, depuis plus de deux ans déjà, l'Allemagne a-t-elle consacré toute son énergie à s'assurer définitivement une influence prépondérante auprès du gouvernement jeune turc. Dès ce moment-là, l'objectif final de sa politique, obtenir l'entrée en guerre à ses côtés de l'Empire, est favorisé par le triomphe de la fraction ultra-nationaliste du Comité Union et Progrès : Talaat, Djemal, Enver sont devenus les vrais responsables de la politique turque, l'un comme ministre de l'Intérieur, l'autre comme ministre de la Marine et le dernier comme ministre de la Guerre.
Ces trois hommes farouchement épris de turquification ne peuvent que se rencontrer avec les adeptes d'un pangermanisme triomphaliste et l'action du baron Wangenheim, alors ambassadeur allemand à Constantinople, homme énergique, réaliste et efficace, va jouer un rôle prépondérant dans ce rapprochement assurément provisoire mais terriblement déterminant.
La Turquie entre donc en guerre aux côtés de l'Allemagne en octobre 1914. Le bombardement par la flotte turque des ports russes de la mer Noire marque la fin d'une période de neutralité pendant laquelle, néanmoins, plusieurs faits ont manifesté clairement de quel côté pencherait la Turquie : traité germano-turc le 2 août, refus de renvoyer la mission militaire allemande, fermeture des Détroits à la navigation commerciale — ce qui gêne la Russie pour ses approvisionnements ; enfin, et surtout, les croiseurs allemands, le Goebben et le Breslau, sont autorisés à naviguer en mer Noire grâce à une soi-disant cession à la Turquie.
Parallèlement, la turquification du pays est en marche — et demeure l'objectif essentiel du gouvernement, comme le reconnaîtra plus tard Djemal : « Notre seul espoir était de nous libérer, à la faveur de la guerre mondiale, de toutes les conventions qui représentaient autant d'atteintes à notre indépendance... Tout comme c'était notre objectif principal d'annuler les Capitulations et le statut du Liban9. » Et, en septembre 1914, le gouvernement décide en effet l'abrogation de toutes les Capitulations ; c'est exactement ce qu'il avait envisagé en janvier 1913 au cours des négociations pour le règlement de la guerre balkanique. Toutes les mesures prises dans cette période montrent que, pour les Turcs, la guerre ne se joue que sur le plan intérieur et dans un climat vivement xénophobe : limitation des activités des missions étrangères (en particulier pour l'enseignement), expulsion des résidents étrangers. En novembre, la proclamation de la Guerre Sainte vient couronner « ce que l'on pourrait appeler la prise de possession du pays par ses propres enfants, qui avaient été trop longtemps privés de leurs droits »**.
C'est à la fin d'octobre 1914, au moment du bombardement des ports russes, qu'en même temps que ses collègues non-musulmans le dernier membre arménien du gouvernement turc, Oskan Mardikian, ministre des Postes, a donné sa démission. Mais ses compatriotes continuent de siéger comme députés à la Chambre et, si le Congrès de la F.R.A. réuni à Erzeroum en août 1914 refuse de lancer aux Arméniens de Russie un appel à l'insurrection contre le gouvernement tsariste, c'est uniquement par un loyalisme envers l'Etat dont ils sont les sujets auquel les Arméniens restent inébranlablement attachés des deux côtés de la frontière. L'élite de la nation refusera donc jusqu'au bout de croire au danger qui la menace et elle continuera jusqu'au bout de mettre sa confiance et son espoir dans une collaboration obstinée avec ce Comité jeune turc dont le programme, au moment de la révolution accomplie ensemble, autorisait certes à penser que les collectivités nationales seraient associées au développement de l'Empire. Mais le nationalisme turc exclut désormais toute idée de fédéralisme et le traitement infligé en 1913 et 1914 à la population grecque, en Thrace d'abord après la reprise d'Andrinople, puis à Smyrne et dans toute l'Asie mineure, montre quelle politique le gouvernement entend appliquer à l'égard des minorités allogènes. La population arménienne, alors estimée par son patriarcat à 2 100 000 personnes, continue à Constantinople, en Cilicie, dans les vilayets d'Anatolie, partout, à mener cette vie laborieuse et traditionnelle dont nous connaissons les difficultés quotidiennes. Paysans, artisans, commerçants, hommes et femmes, tous continuent de travailler, sujets fidèles d'un Sultan dont ils acceptent l'autorité, seulement chargés de l'espoir que leurs doléances aboutiront à leur donner la paix aux côtés des autres membres de la communauté.
C'est cette population qui subit à partir du 24 avril 1915 le premier génocide du XXe siècle.
* - Au début du XXe siècle, la livre turque vaut 22,78 francs, soit 76,07 €.
** - in Hilal, 4 avril 1916 31.
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978