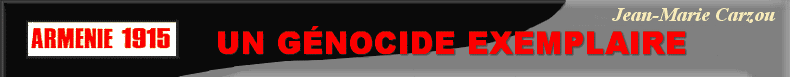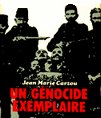L'organisation de la communauté
Sur le plan général de l'organisation administrative de l'Empire, un certain nombre de transformations de structure sont apparues depuis le début du siècle. Les unes ne sont conçues que pour alimenter la panoplie des réformes et, à ce titre, ne sont que peu suivies d'effet. Ici ou là, on arrive à assurer le fonctionnement normal de l'impôt, ou à nommer un fonctionnaire chrétien ; c'est ainsi qu'il arrive que des Arméniens soient nommés juges ou présidents de tribunal, adjoints des valis (gouverneurs), mais jamais valis eux-mêmes, encore qu'il y ait deux exemples d'Arméniens chargés de la responsabilité d'une province, l'un en Roumélie, l'autre au Liban.
D'autres transformations ont été, en revanche, réalisées jusqu'au bout : ainsi en est-il de la loi sur les vilayets de 1861, qui achève de modifier radicalement l'ancienne répartition administrative de l'Empire en eyalets, vastes circonscriptions dont les limites s'étaient naturellement superposées à celles des territoires habités par les nations vaincues passées sous contrôle ottoman. L'instauration d'un nouveau découpage des provinces est un fait de première importance, de par ses effets naturels sur les structures où s'inscrit la vie quotidienne des sujets du Sultan, mais aussi parce que cette organisation semble obéir à des considérations principalement politiques, qui dépassent de loin le simple désir technique d'un meilleur fonctionnement administratif. Il faut signaler en outre que la loi redonne aux représentants locaux du gouvernement un pouvoir très important et, ce qui sera d'une grande influence sur le destin des populations, qu'elle constitue ainsi un retour au système décentralisé d'avant les réformes dans lequel les pachas étaient les maîtres libres et quasi absolus de leurs provinces. Pour les Arméniens en tout cas, l'application, cette fois rapide, de la loi sur les vilayets a pour effet de faire disparaître la notion même d'Arménie. Jusqu'à Mahmoud II, en effet, le territoire d'Anatolie où se trouve l'essentiel de la population arménienne de l'Empire a constitué un eyalet, naturellement nommé Ermenistan ayaleti, c'est-à-dire région d'Arménie ; dans le remodelage, l'eyalet laisse la place d'abord à quatre gouvernements généraux, eux tout aussi naturellement nommés des villes qui en sont les chefs-lieux : Van, Diarbekir (l'ancienne Tigranocerte), Erzeroum et Kharpout (ou Mamouret-ul-Aziz) — puis, en 1861 donc, aux six vilayets qui feront l'objet de la question arménienne : Van, Diarbekir, Erzeroum et Kharpout, plus Bitlis et Sivas. Ainsi il n'y a plus d'Arménie officielle.
Le travail fait pour délimiter les nouvelles circonscriptions va dans le même sens et autorise effectivement à supposer une intention politique très précise derrière l'idée générale de la réforme. Dans ces provinces où la population arménienne a sa plus forte présence, véritable ethnie autochtone, dix fois plus enracinée dans ce sol que les populations touraniennes, on a en effet réparti chrétiens et musulmans de façon à faire disparaître la notion de groupe ethnique identifiable et majoritaire. De plus, on laisse pendant longtemps toutes facilités à l'émigration arménienne vers la Russie. Simultanément, on encourage activement l'installation dans ces provinces de groupes musulmans d'origine le plus souvent nomade, Kurdes surtout dont la soumission est récente et qu'il s'agit de fixer, mais aussi Circassiens et Tcherkesses, parfois par tribus entières. Cette pratique est d'ailleurs courante sur l'ensemble du territoire de l'Empire, comme en témoignent les doléances bulgares en 1876-1877 ou les négociations entre la Turquie et les Puissances ; la présentation officielle de la Turquie à l'Exposition Universelle de Paris de 1867 donne d'ailleurs le chiffre de 413 000 immigrants circassiens pour les seules années 1864 à 1866 *.
Dans les provinces en question, la population arménienne ne constitue plus dès lors qu'un élément ethnique parmi d'autres, coexistant dans les nouvelles structures des vilayets. C'est ainsi que se présentent les statistiques de population et une note du ministère français des Affaires étrangères sur « l'ethnographie de l'Asie Mineure spécialement au point de vue de l'élément arménien », publiée dans le Livre jaune consacré aux affaires arméniennes de 1893-1897, constate « que les Arméniens ne se trouvent en majorité dans aucun vilayet de l'Empire » — et, pour les six vilayets, on arrive selon cette source à un total de 666 435 Arméniens sur 3.607.618 habitants, soit moins de 20 %. Il est vrai que le même document s'achève ainsi : « D'une manière générale, il convient de faire certaines réserves sur les chiffres qui précèdent ; les renseignements statistiques existant sur l'Asie Mineure étant, comme on le sait, très défectueux ». On touche là effectivement à un problème dont l'importance est fondamentale pour la question arménienne dans cette période : chacun va jouer avec les chiffres. Car l'enjeu est essentiel : selon que l'on pourra ou non s'appuyer sur la notion de concentration et d'importance en nombre de la communauté arménienne, on aura un argument très fort pour ou contre l'octroi d'un statut spécial à cette communauté. On verra donc les chiffres varier prodigieusement selon les sources, ou même selon les époques. En 1867, la statistique officielle, toujours pour l'Exposition Universelle, déclare 2,4 millions d'Arméniens pour l'ensemble de l'Empire, dont 2 millions en Asie Mineure ; moins de trente ans plus tard, le Livre jaune que nous venons de citer n'en donne que 1 475 011 pour cette même Asie Mineure. Entre les chiffres officiels turcs et ceux du patriarcat arménien de Constantinople, l'écart est encore plus considérable : autour de 1880, pour neuf vilayets (les six de l'Anatolie orientale, plus Trébizonde, Adana et Alep), les chiffres varient presque du simple au triple — 726 750 Arméniens pour le gouvernement turc, 2 130 000 pour le patriarcat **.
Comme tous les chrétiens sujets du Sultan, les Arméniens subissent également les autres effets d'un système qui tend à renforcer le statut inégal fait aux non-croyants. Qu'il s'agisse de l'impôt sous ses multiples formes, du rapport avec l'administration ou bien de la participation à cette administration, mille témoignages sont là pour montrer que, par-delà les apparences officielles de modernisation du système politique et administratif, la situation réelle garde intacte la vieille distinction d'inégalité entre musulmans et chrétiens. Quant à la justice, c'est le domaine où les choses sont le plus flagrantes, d'autant plus que tout acte y est le reflet de la vie quotidienne : définition et reconnaissance des délits, recherche des coupables, application des peines, protection des victimes, à tous les stades du système éclate une irréductible inégalité de traitement entre musulmans et chrétiens. Là aussi les exemples sont légion et il suffit d'ouvrir n'importe quel document officiel des gouvernements européens, Livres bleus ou jaunes, pour y trouver le récit des pillages, des viols, des meurtres impunis et des condamnations arbitraires que subissent partout les chrétiens.
Quand on sait l'importance dans la vie de la collectivité sociale du pouvoir juridique comme garant du comportement quotidien de tous ses membres, on voit que le sujet musulman, s'il subit effectivement comme son compatriote chrétien le poids d'une administration despotique et archaïque, possède sur lui cet incommensurable avantage d'être assuré dans ses rapports avec lui d'une quasi totale impunité, c'est-à-dire de la liberté de ses actes, véritable privilège, puisqu'il peut à sa guise prendre, frapper, tuer même en maître. Quelles que soient par ailleurs les franchises dont bénéficient les chrétiens, ce privilège exorbitant maintient en tout état de cause les musulmans en position dominante et c'est ce qui rend aux chrétiens le cours de la vie quotidienne de plus en plus intolérable au fur et à mesure que la non-application sans cesse réitérée des réformes d'égalité fait peser sur eux, avec les charges croissantes du système, l'inquiétude elle aussi croissante des musulmans qu'exaspère l'idée seule, mais trop répétée, d'un changement.
Aussi bien, et dans l'exercice même de ces franchises que sont l'exemption du service militaire, la relative autonomie de l'organisation religieuse, la possession du commerce et des moyens de production, les chrétiens ne sont en réalité jamais assurés d'aucune continuité : le fait est particulièrement visible dans les provinces, mais finalement tout autant à Constantinople, où cela frappe davantage puisqu'ils y sont apparemment si bien intégrés au système et si capables d'en profiter. En vérité, les chrétiens ne sont nulle part à l'abri de l'arbitraire. Voilà leur véritable privilège : en plus de l'oppression qui s'applique à tous les sujets du Sultan, subir une autre oppression distinctive, qui a de surcroît l'avantage pour le gouvernement de faire oublier à ses sujets musulmans le poids de la première.
Pour l'organisation propre de la communauté arménienne, l'événement important dans ces années-là, c'est l'établissement de la Constitution de 1863, Constitution nationale arménienne destinée à repréciser le cadre collectif de la communauté dans tous les aspects internes, et pas seulement religieux, de son existence. La violence et l'oppression sont présentes tout autour de la communauté dans ses rapports extérieurs avec l'organisation générale de l'Empire, mais la proclamation de cette Constitution, faite en accord étroit avec le gouvernement et d'ailleurs ratifiée par un firman impérial, manifeste la persistance de cette tolérance, vrai respect des particularismes, qui a caractérisé si longtemps le pouvoir turc dans son attitude à l'égard des minorités chrétiennes. L'ensemble des dispositions de ce texte montre en effet avec quelle liberté d'initiative les Arméniens peuvent encore déterminer leur organisation propre.
Il faut d'abord noter le caractère véritablement démocratique de cette organisation : dans un monde oriental encore établi dans l'autocratie et où les nouveaux modèles de société n'arrivent pas à naître, la communauté arménienne est porteuse d'une tradition originale qui n'exclut aucun membre de la gestion de ses affaires. Certes, il y a une hiérarchie, des chefs, et ces chefs ont souvent tendance à abuser de leur pouvoir, à glisser vers une forme locale de centralisme absolutiste, mais l'ensemble des membres de la communauté reste toujours présent, parfois même comme recours populaire. Ainsi, en 1848 et en 1860, la foule populaire arménienne manifeste à propos de la nomination du patriarche et il faut alors tenir compte de ses opinions. Il y a là, et du fait de l'ancienneté de cette tradition politique, un caractère national qui est extrêmement attachant et que l'historique comme le contenu de la Constitution de 1863 illustrent bien. Succédant aux modifications apportées à partir de 1840 à la composition du conseil national de la communauté, modifications elles aussi ratifiées par le Sultan et destinées à réadmettre tous les membres de la communauté dans la gestion des affaires longtemps réservée aux seuls patriciens, elle résulte d'un travail entrepris en 1859 et soumis à l'assemblée générale du peuple en mai 1860 ; là aussi, chacun donne son avis, et beaucoup de luttes opposent partisans et adversaires du projet. Le texte lui-même s'appuie sur le principe du suffrage universel, avec le patriarche comme chef suprême mais une Assemblée dotée à côté de lui d'un véritable pouvoir de contrôle, et des comités chargés de l'administration, des finances, de la justice et de l'instruction publique. Car, dans le souci de sa langue et de son histoire, la communauté arménienne a donné après 1844 un essor nouveau à son action d'éducation : l'enseignement est gratuit, dispensé aux filles comme aux garçons, et des sociétés philanthropiques organisent même des cours du soir ou du dimanche pour les adultes.
Ce qui frappe aussi, c'est la prédominance à peu près intacte du pouvoir religieux. Le XIXe siècle a apporté quelques éléments de changement avec la naissance de communautés arméniennes catholiques et protestantes (respectivement détachées du patriarcat en 1831 et 1847, et source de nouvelles rivalités), mais l'ensemble de la communauté reste très attaché à sa foi spécifique et peut encore se définir par elle. Cette conviction intime qui lie depuis si longtemps la religion à l'identité explique que le chef religieux soit aussi, encore, le chef temporel et politique de la communauté. C'est à l'église que s'annoncent les décisions importantes, c'est autour de la paroisse que se créent les écoles et les associations : l'organisation religieuse est bien au centre de la vie communautaire, à Constantinople comme dans les provinces.
* - Les conquêtes russes en Asie comme les mutilations territoriales subies par la Turquie en Europe font d'eux des réfugiés musulmans pour qui l'Empire est une terre d'accueil. C'est le revers de l'indépendance acquise par les populations chrétiennes...
** - On trouvera un excellent commentaire sur ces chiffres dans la note collective des Puissances de 1880 (cf. annexes).
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978