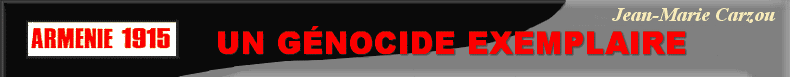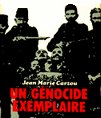Jusqu’au bout (suite)
On rapporte souvent que Talaat se vantait d'avoir fait plus en trois mois pour la solution de la question arménienne qu'Abdul Hamid en trente ans : cela n'est pas faux. On dit aussi que son but était de faire en sorte qu'on ne parlât plus de la question arménienne pendant 50 ans — et c'est bien cette volonté qui semble déterminer jusqu'au bout tous les actes du gouvernement jeune turc. Plus d'un million d'Arméniens sont morts, et le nombre réel des victimes est certainement beaucoup plus près d'un million et demi, les survivants sont dans un état lamentable, ou bien ils se sont réfugiés au Caucase — au moins trois cent mille —, la communauté est complètement disloquée.
Eh bien, ce n'est pas encore assez. Talaat comme Enver se refusent systématiquement à toute mesure d'apaisement, et l'année 1917 voit le génocide se poursuivre : on disperse les enfants recueillis dans les orphelinats allemands, les déportations continuent, les secours sont rendus plus difficiles, en particulier du fait de l'entrée en guerre des Etats-Unis, l'islamisation forcée reprend, les déportés meurent de faim. Certes, au mois d'août, dans une conversation à Berlin avec des missionnaires allemands, Enver déclare adhérer totalement à leurs vues humanitaires et il ajoute : « le principe de tolérance m'est très sympathique. » Mais, au cours de cette conversation, il dit aussi que cela n'est pas en contradiction avec l'attitude prise par la Turquie envers les Arméniens : « Il ne s'est agi à leur égard que d'un problème politique, et non d'un problème religieux... Ce n'est pas contre les Arméniens en tant que chrétiens que le gouvernement a pris des mesures, mais parce qu'ils étaient Arméniens et qu'ils constituaient une menace pour l'Etat16. » En décembre de la même année, Talaat évoque l'idée d'une « amnistie de réhabilitation » pour les Arméniens, qui serait accompagnée de dédommagements financiers ; au mois de mars 1918, il renouvelle sa promesse de « proclamer bientôt une amnistie16. » Mais rien n'est fait et, l'été venu, Enver refuse « d'autoriser sans réserves et sans limites le retour des Arméniens16 », sous prétexte des opérations militaires et de la sécurité ; les diplomates allemands ne sont pas dupes et l'accusent clairement « de justifier le meurtre de plusieurs milliers de personnes et de paralyser les efforts... en vue de sauver les Arméniens16. » Quelles que soient les déclarations officielles, la politique du gouvernement n'a donc pas dévié d'un pouce depuis 1915 dans son objectif d'élimination des Arméniens de Turquie : le processus est ininterrompu.
Mais les événements se précipitent avec le déclenchement de la révolution russe. Jusque-là, la situation militaire sur le front du Caucase est restée stable après l'avance russe de 1915-1916 : occupation d'Erzeroum et de Trébizonde au début de 1916, échec d'une offensive turque en juillet. La majeure partie de l'Anatolie orientale est alors sous le contrôle des autorités militaires russes, ce qui laisse un répit aux réfugiés arméniens du Caucase et permet aux provinces arméniennes de vivre dans un régime de semi-autonomie. Mais tout change quand le triomphe des bolcheviks donne la priorité à la politique de paix à tout prix de Lénine et entraîne le décrochage des troupes russes. L'abandon du terrain conquis en Anatolie est d'abord spontané, car les soldats, qui sont las de se battre, veulent aussi retourner chez eux pour profiter du partage des terres ; après l'armistice d'Erzindjan de décembre 1917, le traité de Brest-Litovsk voit en mars 1918 la République fédérale russe des Soviets accepter officiellement d' « assurer l'évacuation aussi rapide que possible des provinces de l'Anatolie orientale et leur restitution méthodique à la Turquie ». L'article 4 de ce traité stipule également que « les cercles d'Ardahan, de Kars et de Batoum seront évacués sans retard par les troupes russes43», et les Russes vont même, dans un traité additionnel, jusqu'à promettre de démobiliser et disperser les troupes arméniennes. L'armée turque est déjà repartie à l'attaque, rompant unilatéralement l'armistice de décembre, réoccupant « ses » provinces, envahissant les autres en février.
Les Arméniens sont alors tout à fait seuls. En leur retirant la protection militaire, la débâcle russe a laissé le champ libre à l'offensive turque et les réfugiés voient déferler à nouveau l'horreur et les massacres. L'Arménie russe, elle-même, n'est plus à l'abri et, pendant que la fièvre des nationalités s'empare de tous les peuples libérés du tsarisme, encouragée par les proclamations des Soviets, sur place, il faut lutter pour sauver la patrie. Dès novembre 1917, la défense s'organise avec quelques troupes qui doivent lutter dans des conditions épouvantables. Et lutter seules, car les Russes ont tout abandonné, pris par leurs propres efforts pour consolider la révolution et s'opposer aux armées blanches ; sur place, malgré les efforts pour rassembler les peuples du Caucase, les tensions restent vives entre Arméniens et Géorgiens, ainsi qu'avec les Azerbaïdjanais musulmans que tout rapproche des Turcs.
Et la pression turque est extrêmement forte. La IIIe armée est encore solide et, profitant de la situation, elle avance au-delà d'Erzeroum, reprend Kars en avril 1918, pousse vers Bakou — et c'est le moment où Enver croit pouvoir réaliser les grands rêves du pantouranisme. En Arménie même, les Turcs sont maîtres du terrain, même si un sursaut héroïque des troupes et de la population arméniennes permet, par la victoire de Sardarabad, de sauver une minuscule portion de l'Arménie russe qui s'érige en République indépendante le 28 mai. Cette République de l'Arménie n'occupe que 9 000 km², les difficultés économiques, sanitaires et sociales sont immenses, accrues par la présence désolée des centaines de milliers de réfugiés qui ont pu échapper au génocide. La paix elle-même n'est guère assurée et, à peine indépendante, l'Arménie doit signer avec la Turquie le traité de Batoum (4 juin 1918) dont l'article premier stipule « qu'il y aura une paix durable et une amitié constante entre le gouvernement impérial ottoman et la république arménienne ». En fait, le traité impose aux Arméniens l'acceptation des clauses les plus défavorables de Brest-Litovsk et, comme il s'attarde très longuement et très précisément sur la protection des droits de la communauté musulmane minoritaire (allant jusqu'à définir le règlement de ses liens avec le Cheik-ul-Islamat qui se trouve à l'extérieur du territoire national arménien), on voit clairement que la Turquie n'a pas renoncé à vouloir toujours imposer sa loi. Cela confirme l'analyse faite en mai par un observateur militaire allemand : « L'exigence démesurée des Turcs, qui vise les territoires purement arméniens d'Akalkalaki, Alexandropol et Erivan, va bien au-delà du traité de Brest vers une exploitation exclusive du Caucase et une extermination totale des Arméniens transcaucasiens16. » Et, au même moment, le consul allemand à Alep signale que de nouvelles mesures sont prises contre les survivants.
Mais l'automne 1918 apporte soudain un peu de lumière : les Puissances alliées l'emportent partout et enfoncent le front turc en Thrace, en Palestine et en Syrie ; Constantinople est à nouveau menacée et les Jeunes Turcs démissionnent. C'est donc un nouveau gouvernement, dirigé par Izzet, qui signe l'armistice de Moudros en octobre, bientôt suivi par l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Les Alliés entrent à Constantinople, ils occupent aussi les Détroits, Batoum et Bakou, imposent la démobilisation de l'armée turque, la reddition de ses garnisons au Moyen-Orient et l'internement de ses navires de guerre.Le traité de Brest-Litovsk est donc aussitôt caduc (les Russes le dénonceront en novembre) et les perspectives de la paix s'ouvrent.
Malgré une guerre brève et malheureuse contre la Géorgie, malgré le peu de soin mis par les autorités alliées d'occupation à s'assurer de la démobilisation des troupes turques, c'est pour les Arméniens le temps de l'espoir. Même s'ils ne sont plus très nombreux pour en profiter, même si ce ne sera qu'à travers le voile de tant de morts, ils voient enfin proche la possibilité de réunir Arméniens de Turquie et Arméniens de Russie dans un Etat libre et reconnu, aux dimensions de l'Arménie historique, renaissant miraculeusement par-delà tous les projets alliés de partage, par-delà toutes les tentatives turques de destruction. Les dirigeants arméniens concentrent donc leurs efforts sur la négociation qui s'ouvre à Paris : si graves et si déterminants que soient sur le terrain leurs problèmes, si fort que soit le danger sur place, c'est là qu'ils tournent leurs regards, c'est là qu'ils tentent non seulement de sauver mais d'affermir et d'officialiser définitivement leur République — mettant encore une fois leur espoir dans le recours aux grandes puissances.
Deux délégations sont installées pour cela à Paris, l'une dirigée par Boghos Nubar, qui représente depuis 1913 le conseil mixte arménien de Constantinople, l'autre par Aharonian, qui représente la jeune République. Et c'est l'explosion de toutes les aspirations si longtemps contenues : de la simple autonomie jusqu'à l'Arménie des deux mers, toutes les solutions sont envisagées et proposées, et tous espèrent bien obtenir au moins l'insertion dans le nouvel Etat, non seulement des six vilayets (plus un accès à la mer à Trébizonde), mais aussi de la Cilicie, cette deuxième Arménie qui doit aujourd'hui elle aussi être arménienne. Et les interventions reprennent, non plus cette fois pour sauver les victimes du génocide, mais pour arracher toutes les réparations ; et l'on multiplie les documents, les preuves, les chiffres, on rappelle le soutien militaire apporté tant aux Alliés que sur le front russe par les volontaires arméniens, les légionnaires arméniens. Partout ainsi fleurissent à nouveau les comités de soutien, les meetings, les discours aux parlements : vive l'Arménie! Et le 28 mai 1919, pour le premier anniversaire de la République, le gouvernement d'Erivan publie une « déclaration d'indépendance de l'Arménie unifiée » qui débute ainsi : « Pour reconstituer l'Arménie dans sa totalité et pour assurer l'entière liberté et la prospérité du peuple arménien, le Gouvernement de l'Arménie, fidèle interprète de la volonté du peuple arménien et du désir exprimé par lui, déclare qu'à dater d'aujourd'hui les différentes parties de l'Arménie qui avaient été séparées jusqu'à maintenant sont réunies à jamais en une unité d'Etat indépendant43. »
Pendant ce temps, à Constantinople, le nouveau gouvernement donne d'abord l'impression qu'il va reconnaître et condamner officiellement le génocide : tout le monde va proclamant la culpabilité des « Unionistes » dans les malheurs de la Turquie et, en 1919, a lieu le procès d'un certain nombre de membres du Comité Union et Progrès. Certes, on pourra dire plus tard que ce procès n'a eu lieu que sous la pression des autorités d'occupation. Mais il permet de définir les responsabilités des dirigeants jeunes turcs : on leur reproche essentiellement d'avoir engagé le pays du mauvais côté dans une guerre de plus mal préparée qui s'est révélée finalement néfaste, d'avoir agi sans consulter les représentants du peuple et d'avoir ainsi subordonné les intérêts nationaux aux leurs en formant pour ainsi dire un véritable gang ; et quelques-uns d'entre eux sont également accusés pour les massacres et les pillages qui ont accompagné la déportation des Arméniens. Mais, si ces documents (qu'on trouvera en annexe) sont intéressants pour nous parce qu'ils apportent un témoignage de plus sur les événements de 1915, il ne faut pas se cacher que ces accusations ne constituent pas le début d'une nouvelle politique turque à l'égard des crimes du passé.
Il apparaît très vite qu'il ne s'agit là que d'une tactique destinée à impressionner favorablement les Puissances entre les mains desquelles se trouve désormais le sort du territoire, puisque les pourparlers de paix viennent de commencer. Ainsi, quand la délégation turque se présente à Paris en juin 1919 pour la négociation, Damad Ferid pacha, qui la dirige, prend bien soin dans sa déclaration de circonscrire les atrocités commises par ses prédécesseurs : « Je n'aurais pas l'audace de me présenter devant la Haute Assemblée si je croyais que le peuple ottoman ait encouru, dans une guerre qui mit à feu et à sang l'Europe et l'Asie, une part quelconque de responsabilité...
« Au cours de la guerre, presque tout le monde civilisé s'est ému au récit des crimes que les Turcs auraient commis. Loin de moi la pensée de travestir ces forfaits qui sont de nature à faire pour toujours tressaillir d'horreur la conscience humaine. Je chercherai encore moins à atténuer le degré de culpabilité des acteurs du grand drame. Le but que je me propose est de montrer au monde, avec des preuves à l'appui, quels sont les véritables auteurs responsables de ces crimes épouvantables...
« Au sujet des autres événements tragiques, je me permettrai de répéter ici ce que j'ai maintes fois déclaré devant le Sénat ottoman. La Turquie déplore le meurtre d'un grand nombre de ses co-nationaux chrétiens, autant que le meurtre des musulmans proprement dits. En effet, non content des crimes perpétrés contre les chrétiens, le Comité Union et Progrès voua à la mort, par tous les moyens, 3 millions de musulmans. Quelques centaines de mille de ces malheureux, chassés de leur foyer, errent encore aujourd'hui au centre de l'Asie mineure, sans gîte, sans aucun secours d'existence. Et s'ils retournaient dans leur province, ils se trouveraient aussi dépourvus, car un grand nombre de villes et de villages musulmans et chrétiens ont été détruits à dessein. L'Asie mineure, aujourd'hui, n'est qu'une vaste ruine. Le Gouvernement, malgré sa vigilance, n'a pu atténuer encore l'effet désastreux du cataclysme...
« Ce qu'il faut écarter, c'est l'hypothèse d'un conflit de race ou de l'explosion du fanatisme religieux. D'ailleurs, le peuple turc, à une époque où la violence pouvait avantageusement lutter contre le droit, a su respecter la vie, l'honneur, le sentiment sacré des nations chrétiennes soumises à sa loi...
« La vérité commence depuis quelque temps à pénétrer dans l'opinion publique européenne. Le grand procès des Unionistes à Constantinople a montré les responsabilités des chefs du Comité, qui tous occupèrent les plus hautes fonctions de l'Etat, en ce qui concerne la guerre et les événements tragiques : c'est la réhabilitation de la nation ottomane.38»
Le procès auquel il est fait ici allusion est celui dont nous venons de parler : entamé en mars, il aboutit en juillet à la condamnation à mort de Talaat, Enver et Djemal, et s'achève en janvier 1920 ; mais, comme les trois chefs du Comité, la plupart des accusés sont en fuite et ils sont jugés par défaut. Le verdict ne sera appliqué que pour des dirigeants de second plan, en particulier Kemal bey, l'un des responsables du sandjak de Yozgad, auquel la foule turque de Constantinople fera spontanément des obsèques grandioses qui, mieux que toute autre manifestation, disent clairement que le consensus entre le gouvernement jeune turc et la population était bien réel. Il est également clair que le nouveau gouvernement ne cherche qu'à améliorer la position de la Turquie en rejetant sur les Jeunes Turcs les « crimes » dont l'accusent les Alliés, et nullement à les reconnaître et à en assumer les conséquences. Et les revendications que Ferid pacha présente tout aussitôt sont fermes, étonnamment fermes même pour un Etat vaincu, puisqu'il ne s'agit de pas moins que de conserver à la Turquie ses frontières d'avant la guerre, et même de les améliorer du côté européen. Les mois qui suivent jusqu'à la signature du traité de Sèvres (août 1920) voient donc renaître la querelle des statistiques de population, élément fondamental pour asseoir les prétentions territoriales ; et la délégation turque ne manque jamais alors d'insister sur la disproportion entre les populations arméniennes et turques dans les provinces que l'on se dispute. On est bien loin d'une reconnaissance du génocide, et c'est toujours la même pensée qui anime les dirigeants turcs : comment éviter encore les mutilations territoriales, un véritable démembrement cette fois ? Ils combattent donc énergiquement les revendications arméniennes, et un journal de Constantinople n'hésitera pas à écrire : « On projette de créer une Arménie dans nos provinces orientales, on veut donc constituer une République des Morts ?42 »
De leur côté, les grandes puissances n'ont pas changé. Elles n'ont toujours en vue que le partage du butin et les négociations essentielles portent, dans la ligne des accords secrets qui ont parsemé les années de guerre, sur la redéfinition des zones respectives d'influence. Dès la fin du conflit, chacune se retrouve avec ses propres problèmes, ses intérêts propres, sa vision du rôle qu'elle doit jouer dans la gestion future du monde. Et dans ces préoccupations, les petits ne tiennent finalement guère de place : l'Arménie n'est pas admise à participer officiellement aux travaux de Versailles, son adhésion sera plus tard refusée aussi lors de la création de la Société des Nations et les Alliés paraissent davantage soucieux de poursuivre entre eux le partage de l'Empire ottoman. Certes, l'Arménie est en janvier 1920 reconnue de facto par le conseil suprême de la conférence de la paix, elle participe aux travaux préparatoires du traité qui doit régler le sort de la Turquie et elle obtient enfin d'éclatantes réparations dans ce traité qui est signé à Sèvres en août 1920 : reconnaissance de jure par tous les signataires, y compris la Turquie, « comme un Etat libre et indépendant » (article 88), 85 000 km² et un accès à la mer. C'est le 22 novembre que le président Wilson, dont l'arbitrage avait été demandé, détermine ces limites territoriales.
Mais il est déjà trop tard. Le traité de Sèvres ne représentera pas l'aboutissement d'une politique efficace, mais seulement le triomphe éphémère du rêve. Car, en accord avec le courant isolationniste, le Sénat américain refuse de le ratifier, désavouant ainsi le président Wilson, comme il a déjà refusé en juin d'accepter un mandat sur l'Arménie. Dès le début de l'année 1920, les délégués arméniens ont en effet compris que rien ne serait facile : voyant les Alliés prêts à évacuer la Turquie, ils ont cherché la protection de l'un d'entre eux, offrant leur pays contre un mandat qui empêcherait l'attaque turque, retrouvant ainsi l'attitude de leurs pèlerins du XVIIIe siècle allant demander dans les cours européennes l'indépendance de l'Arménie. Tous refusent et les Etats-Unis ne sont que les derniers à refuser. Car les grandes puissances sont fatiguées et la guerre ne les intéresse plus : c'est le commerce, les liens économiques propices à leur stratégie qui comptent maintenant, donc les rapports de force.
Et, face au rêve arménien, deux forces déterminées à agir avec réalisme ont repris les rênes dans cette région du monde : le mouvement kémaliste et la République des Soviets. Après s'être consolidée en repoussant les attaques blanches, celle-ci entend bien recouvrer la totalité de l'héritage du Tsar. Au Caucase, elle a investi l'Azerbaïdjan en avril 1920 et elle fera de même en Géorgie en février 1921 ; entre-temps, les organisations communistes se sont regroupées en Arménie et, bien qu'elles échouent en mai dans une tentative de soulèvement contre le gouvernement daschnak, elles sont prêtes à prendre le pouvoir. De son côté, Mustapha Kemal, qui, en grand homme d'Etat, va sauver son pays, a vu sa révolte d'août 1919 consolidée par le ralliement des troupes d'Anatolie et de leur chef, Kiazim Karabekir ; il a pu, après des congrès tenus — et ce n'est pas par hasard — à Erzeroum et à Sivas, s'assurer un contrôle du cœur du pays déjà suffisant pour établir en janvier 1920, à Angora, une grande assemblée qui vote le Pacte National de l'irrédentisme. Au moment où les délégués de Constantinople signent pour la Turquie le traité de Sèvres, ils ne représentent donc plus les forces vives du pays et Kemal est prêt à reconquérir le territoire turc contre tout le monde, y compris les autorités alliées d'occupation.
Et c'est lui qui donne le signal en lançant ses troupes contre la République d'Arménie avant même la signature du traité de Sèvres, qu'il désavoue de toute façon. Les Soviétiques laissent faire ; ils accueillent des représentants de Kemal au Congrès des peuples d'Orient qui se tient à Bakou et au cours duquel Zinoviev déclare le 1er septembre : « Nous soutenons avec patience les groupes qui ne sont pas encore avec nous et qui sont même, dans certains cas, contre nous. Tel est le cas de la Turquie, par exemple, où, comme vous le savez, camarades, le gouvernement soviétique prête son appui à Kemal Pacha36. » En novembre, les Turcs occupent Alexandropol et les Arméniens doivent accepter un armistice qui conduit le 2 décembre à un traité qui annule celui de Sèvres. Simultanément, les Soviétiques sont entrés en Arménie, ils ont imposé la participation de leurs représentants au gouvernement et, le 2 décembre également, l'Arménie est devenue République soviétique.
Il ne reste plus qu'à entériner tous ces événements que la force armée a imposés ; c'est le rôle du traité de Moscou de mars 1921 dont le préambule dit ceci : « Le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale de Turquie et la République fédérative et socialiste des Soviets russes reconnaissant d'un commun accord le principe de la liberté des Nations et le droit de chacune d'elles de disposer librement de son sort et prenant en outre en considération la lutte commune entreprise contre l'invasion de l'impérialisme et prévoyant que les difficultés suscitées à l'un rendraient la situation de l'autre critique, ont décidé la conclusion d'une convention en vue d'assurer des relations amicales et fraternelles entre les deux pays43. » En prime, le Nakhitchevan est placé sous la protection de l'Azerbaïdjan et un deuxième traité signé à Kars en octobre 1921 confirme toutes les dispositions du premier avec la signature cette fois des républiques transcaucasiennes qui, après l'union politique en mars 1922, se retrouvent fédérées en décembre 1922 et aussitôt membres de l'U.R.S.S.
Entre-temps, après une brève reprise du pouvoir au printemps 1921, les représentants de la République d'Arménie ont déclaré à Paris, en juin 1921, dans un texte publié en commun avec les représentants des autres Républiques transcaucasiennes (Azerbaïdjan, Caucase du Nord et Géorgie), que ces actes étaient « dépourvus de toute valeur légale... et comme nuls et non avenus43 »... Peu importe désormais, puisque, devant d'autres réalités, c'est à présent celle-ci qui est nulle et non avenue : le grand rêve de la réunification de toutes les provinces arméniennes. La grande Arménie, l'Arménie tout simplement, n'est pas ressuscitée : les provinces qui étaient russes le sont restées, les provinces qui étaient turques ont disparu. C'est tout.
Pour l'Arménie turque en effet, après la fin du rêve de réunification, c'est l'accomplissement définitif du génocide. Dans la guerre d'indépendance que mène Kemal contre les Arméniens, mais aussi contre les Grecs, chaque parcelle du territoire national qu'il reconquiert est le lieu à nouveau d'incendies, de pillages, de massacres — c'est ce qui arrive à Smyrne en 1922. Il en va de même dans les provinces occupées par les Alliés, au fur et à mesure que ceux-ci les évacuent. Il en va ainsi en fait jusqu'à ce que Kemal obtienne à Lausanne en juillet 1923 le résultat qu'il s'était donné comme but en 1919 et vers lequel il a continûment tendu toutes ses forces : la création d'une nation turque homogène, libérée des Capitulations et de l'occupation étrangère, en échange de la reconnaissance par le nouveau régime de la Dette publique ottomane. Ce succès lui vaudra l'appellation d'Atatürk : « père des Turcs » ; ce faisant, il parachève aussi la réussite du génocide par un prolongement logique de l'action des chefs jeunes turcs*. Car, à Lausanne, il n'y a plus du tout d'Arménie. Certes, durant les discussions préliminaires, Ismet, que Kemal a désigné pour représenter la Turquie, déclare « que les Arméniens voulant rester en Turquie pourront vivre fraternellement avec leurs compatriotes turcs qui seront pleins de sollicitude envers eux et oublieront volontiers tous les événements du passé39 ». Mais il s'oppose à toute mesure pouvant paraître limiter la souveraineté turque, en particulier à la création sur le territoire de la Turquie d'un foyer national arménien, et le traité entre la Turquie et les puissances alliées ne mentionnera même pas le nom de ce pays dont la plus grande partie du territoire se retrouve pourtant sous domination turque, y compris les districts de Kars et Ardahan que les Soviétiques ont dû abandonner en 1921. A Lausanne, et ceci est conforme aux ambitions du Pacte National de janvier 1920, il n'y a rien pour l'Arménie turque : rien, ni indépendance, ni mandat, ni foyer national, ni statut spécifique, ni autonomie, rien, pas même les bonnes vieilles réformes de 1914. Et ce dernier traité international sur la question a été rédigé exactement comme s'il n'y avait jamais eu ni Arménie ni Arméniens à l'ouest de l'Ararat. Quinze jours plus tard, à Lausanne également, les Etats-Unis signent avec la Turquie un traité bilatéral « d'amitié et de commerce ».
Aux victimes, aux réfugiés, ne reste donc comme seul recours que « la sympathie universelle », qui se manifeste désormais chaque année, dans l'enceinte de la S.D.N., par des propositions tendant à la création quelque part d'un foyer national arménien ou à la sauvegarde des réfugiés, par des résolutions aussi, surtout par des discours très beaux. Ainsi en est-il de celui que prononce au cours de la cinquième assemblée de la S.D.N., le 25 septembre 1924, M. de Brouckère (Belgique) dont André Mandelstam dit qu'il a trouvé « les accents les plus émouvants pour élever le problème arménien au-dessus d'un niveau purement philanthropique » :
« En pareille matière, il faut être prudent et la cinquième Commission vous propose de conclure simplement à une étude — non pas pour écarter la question ou en retarder la solution, mais simplement pour pouvoir vous apporter cette solution d'une façon plus ferme et plus éclairée.
« Etablissement des réfugiés arméniens au Caucase! Etablissement des réfugiés arméniens dans le reste du domaine arménien! Où est-il ? Quelles en sont les limites ? Ah! mesdames et messieurs, nous aurions pu croire, il y a peu de temps, que ces limites étaient tracées : elles avaient été tracées par une haute autorité, par ce Président Wilson dont nous conservons tous pieusement la mémoire. Nous sommes bien obligés de reconnaître aujourd'hui qu'elles ne sont plus tracées, mais tout au moins convient-il d'affirmer bien haut qu'elles ne sont pas tracées, qu'elles n'ont été fixées ni en faveur des Arméniens ni contre eux et que le problème reste ouvert.
« Il y a là un problème politique que je me garderais bien d'examiner car je me souviens que le rapport est présenté au nom de la cinquième Commission et pas au nom de la sixième Commission.
« Nous reconnaîtrons tous qu'il semble que le moment ne soit pas venu de tenter la solution politique du problème : les circonstances ne paraissent pas favorables. Il faut donc attendre. Mais il y a deux manières d'attendre : attendre dans l'inaction, attendre en préparant. C'est cette seconde manière d'attendre que recommande la cinquième Commission40. »
* - Après avoir été condamnés à mort par le régime auquel Kemal s'oppose, Talaat et Djemal seront assassinés par les Arméniens et Enver tué au Turkestan dans une ultime tentative de soulèvement pantouranien aux côtés des Basmatchis en lutte contre le pouvoir soviétique.
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978