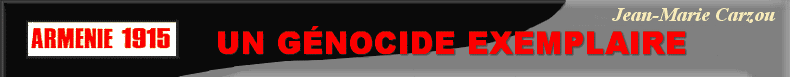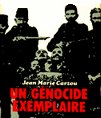La question d'Orient
Avec le XIXe siècle naissant, à peine apaisés à l'Ouest les soubresauts de la Révolution et de l'Empire, tout commence de changer. En 1812 déjà, la Serbie, la Principauté de Servie, comme on la nomme à l'époque, a commencé de se libérer du joug turc et a, la première, conquis son autonomie. Et les vingt années précédentes ont vu Catherine rêver à Saint-Pétersbourg, Napoléon rêver à Paris de ce que serait un formidable mouvement d'annexion des terres de l'Empire ottoman ; dans ces rêves, comme dans beaucoup d'autres projets de partage qui s'échelonnent dans le cours du XVIIIe siècle, il y a assurément les premiers signes de ce renversement de tendance que nous avons signalé plus haut.
Mais c'est après 1815, quand le Congrès de Vienne a pour un temps réglé les problèmes continentaux des grandes puissances, que se mettent clairement en place les différents éléments de ce jeu diplomatique qui, sous le nom de Question d'Orient, va, de ce côté du monde, occuper les chancelleries durant tout le siècle. Les pièces du jeu sont au nombre de trois : expansion des puissances européennes, déclin de l'Empire ottoman, réveil des minorités chrétiennes de cet Empire. Notons tout de suite que l'ordre des facteurs importe peu ici, car il suffit de la coïncidence ou de l'enchaînement de deux d'entre eux pour que l'engrenage se mette en route — et le retour à l'indépendance de la Grèce sera à ce titre parfaitement exemplaire d'un phénomène que l'on verra se renouveler dix fois dans le siècle.
Il est clair qu'au départ la coïncidence entre l'accélération du déclin de l'Empire ottoman, dont la faiblesse devient manifeste, et l'essor des puissances européennes suffit pour ouvrir la Question d'Orient. Et l'on peut très bien reprendre pour la définir l'image simple et habituelle de « l'homme malade » au chevet duquel se précipitent nombre d'héritiers présomptifs, que leur soif de domination a fait se déclarer tels, la Russie obstinément attachée au vieux désir de refaire de Constantinople la « Tsargrad » que la foi orthodoxe qui fut celle de Byzance lui assigne comme but ultime, en même temps obsédée de cet accès méridional à la mer libre que lui ouvrirait la possession des Détroits, l'Angleterre de plus en plus lucidement soucieuse de garantir la route de ses Indes et par là fondant désormais toute sa politique dans la région sur un constant rééquilibrage de toutes les influences, la France toujours amoureuse de sa Méditerranée et sentimentalement tournée vers ces espaces du Moyen-Orient dont la protection fut si souvent un de ses titres de gloire, tous avides de se ménager une place dans cette Turquie d'Asie stratégiquement décisive pour leurs divers desseins.
Bien sûr, comme au temps des Croisades, c'est un noble mobile qui guide toute leur action : aider, protéger, libérer les malheureuses populations chrétiennes, nos sœurs trop longtemps opprimées ; et il est vrai que l'Europe agira parfois dans ce sens. Mais nul n'ignore les véritables motifs de cette sollicitude qui fera des six ambassadeurs européens à Constantinople une sorte de pouvoir occulte sans cesse occupé à répercuter sur le Sultan et sur la Sublime Porte les pressions et les « conseils amicaux » des Puissances : l'extension des zones d'influence au-delà des frontières européennes est devenue un objectif majeur et, au chevet de l'homme malade, les grands héritiers ne cherchent qu'un accroissement de leurs profits. Dans les querelles soupçonneuses qu'ils vont se livrer, sûrs qu'ils sont d'avoir les mêmes visées, les populations chrétiennes de l'Empire ottoman ne serviront donc souvent que d'enjeu vite oublié alors même qu'elles risquent tout et que la sollicitude dont elles sont l'objet ne peut, si elle n'est pas suivie, que leur nuire auprès de ce gouvernement turc qui est encore le maître quasi absolu de leur survie ou de leur mort.
En dehors même des liens qui les unissent aux Etats chrétiens d'Europe, ces populations sont d'ailleurs en train de vivre à l'intérieur de l'Empire ottoman, comme l'ont fait un peu plus tôt celles d'Europe centrale et méridionale, les prémices de la renaissance nationale qui sera l'un des autres traits dominants du XIXe siècle. Cela va d'abord lentement, car, quelle que fût la tolérance ottomane à leur égard, l'empreinte de tant d'années d'asservissement est profonde et l'on ne se réveille pas en un jour de tant d'abandons. Mais quelque chose est en train de commencer qui, au-delà de la religion, redessine les traits oubliés d'une identité et tout va servir à leur donner cette précision et cette réalité sans lesquelles il n'y a pas pour un peuple d'indépendance possible.
Or l'Empire ottoman est lui-même en train de changer. Face à l'évolution conquérante de l'Europe, il est vrai que le mouvement de ce grand corps l'entraîne depuis un temps, de façon presque irrésistible, au déclin. En dehors de variations normales aux périphéries mouvantes de son domaine, l'Empire ottoman forme encore un Etat, et le même depuis 350 ans. Mais rien n'a bougé dans son organisation intérieure. Comme si elles avaient été immuablement fixées, les lois qui le régissent restent celles de Soliman ; quelques essais de modifications ont eu lieu, en particulier vers 1760 sous la conduite de Reghib pacha, mais rarement suivies d'effet et peu à peu abandonnées, et les différents éléments qui animent la vie de l'Empire, les mêmes en 1500 et en 1800, semblent devoir entretenir éternellement les mêmes rapports traditionnels. Tout se dégrade cependant et bientôt la machine ne fonctionnera plus, faute d'avoir subi à temps les révisions indispensables.
Un homme va le comprendre et tenter de résister, c'est Mahmoud II, Sultan lucide et patriote, conscient qu'il n'est peut-être pas trop tard pour sauver son Empire : dans les années 1825, c'est une véritable politique de réformes qui est pour la première fois entreprise. Il faut néanmoins signaler que son prédécesseur presque immédiat, Sélim III, qui régna de 1789 à 1807, avait lui-même tenté déjà une réorganisation, d'abord militaire, des structures de l'Empire, conscient déjà que ce serait pour son pays le seul recours contre les inévitables assauts de l'Europe — car, déjà, la Russie se fait pressante à ses frontières, et puis l'Autriche et bientôt tous les autres. Et c'est de cette époque que l'on peut dater le clivage entre partisans et adversaires des réformes, c'est-à-dire la naissance de l'esprit jeune turc qui animera constamment durant tout le XIXe siècle une partie importante de l'élite ottomane, esprit d'apparence libérale mais qu'il faut définir très exactement ainsi : emprunter à l'Europe tout ce qu'il est nécessaire d'acquérir pour résister efficacement à l'Europe — c'est un nationalisme, et il est fidèle au Coran, ainsi que le cite un historien turc : « Employez, pour vaincre les Infidèles, tous les moyens qui sont en votre pouvoir10 ».
Mais il subsiste bien évidemment un esprit « vieux turc », alimenté par la persistance des influences religieuses sur lesquelles le pouvoir s'est toujours appuyé ; de cette tendance réactionnaire et pour ainsi dire intégriste, les représentants les plus significatifs sont aussi bien les ulémas, gardiens naturels de la religion et qui refusent toute évolution dans la relation avec les non-croyants, que les janissaires, qui sont devenus une véritable garde prétorienne. C'est à Mahmoud II que revient donc l'honneur d'avoir véritablement entamé le processus qui doit conduire l'Etat ottoman au statut de nation capable de survivre en s'adaptant : à travers des péripéties variées, il se débarrasse des janissaires par un massacre organisé en 1826 ; il fait appel à des officiers européens pour rénover son armée, il veut modifier, en des gestes symboliques qui touchent le vêtement, le comportement séculaire de ses sujets.
Mais est-ce assez ? Après la Serbie, c'est la Grèce qui échappe au pouvoir du Sultan, au travers d'un processus qui rassemble pour la première fois tous les rouages de la Question d'Orient : de 1821 à 1829, à travers les combats, les querelles intestines, l'appel aux puissances européennes et leur intervention progressive (pressions de l'opinion publique, engagement individuel des philhellènes tels que Lord Byron, négociations des Puissances, action militaire directe), la révolution grecque, déclenchée par l'insurrection d'Ypsilanti, mène à la paix d'Andrinople qui assure l'indépendance du pays. Tout est là : le désir européen d'intervention, le réveil d'un peuple opprimé, l'affaiblissement de l'Empire asservisseur et, son terrible corollaire, les premiers massacres : Chio... c'est plus que quelques vers de Victor Hugo ou qu'une peinture de Delacroix, c'est la mise en route de l'engrenage où durant tout le siècle l'insurrection et l'oppression, le réveil indigène et l'action européenne s'entraîneront sans fin l'un l'autre. Et la liste est longue des autres pays où le processus se renouvelle : Monténégro, Bulgarie, Roumanie, Bosnie-Herzégovine, Liban, Crète, Macédoine, Albanie... Arménie.
Parallèlement, dans le fonctionnement même de l'Empire, la dégradation est maintenant partout visible, inexorable accompagnatrice du déclin : finances, puissance militaire, administration, rien ne va plus. Faute d'argent, mais aussi d'un budget, l'Etat est sans cesse en situation de cessation de paiement face à ses employés, à ses soldats ; le brigandage, les excès des fonctionnaires locaux ont donc repris de plus belle. La monnaie s'échange largement au-dessous de sa valeur nominale et, comme il n'y a ni industrie ni organisation des travaux publics, c'est encore un élément d'aggravation pour le Trésor. Et le gouvernement paraît incapable de lutter contre ces maux traditionnels de l'Orient que sont la corruption et l'apathie. Pour les populations, le temps de l'oppression est revenu et il est frappant de constater comme elle est égale pour tous, la vieille distinction religieuse ne servant plus de rien devant les problèmes économiques : musulmans comme chrétiens, tous subissent les caprices arbitraires de fonctionnaires corrompus qui ne songent qu'à s'enrichir. Les corvées, les impôts sont de plus en plus lourds et davantage encore, bien sûr, pour les chrétiens à qui tout devient intolérable au moment même où se réveille le souvenir de leur liberté. De là naîtront les insurrections, et les premières révoltes. Mais l'on ne sait encore bien d'où jaillit l'étincelle qui va tout mettre en mouvement après tant d'immobilité commune : est-ce d'une aggravation de l'oppression, soudainement renaissante comme aux temps de la conquête ? Est-ce de ce réveil aigu des nationalités ? Est-ce enfin, simplement, l'effet des ambitions européennes, désireuses de nourrir les prétextes d'une intervention trop intéressée ? Chacun peut, selon son parti, préférer l'une ou l'autre de ces hypothèses que les adversaires vont se renvoyer longtemps comme autant d'accusations. Peut-être, en fait, entre-il beaucoup des trois dans la vérité de cette période...
1839 : Abdul Medjid, qui a succédé à son père Mahmoud II, poursuit l'œuvre de la réforme. La charte de Gul-Hané ouvre l'ère du Tanzimat, période durant laquelle triomphe l'esprit jeune turc.
1854 : Premier emprunt contracté par l'Empire ottoman. C'est le début d'un processus qui, de dépenses militaires (qui engloutiront jusqu'à 67,8 % des ressources) en dépenses somptuaires, d'avances en emprunts nouveaux, mènera l'Empire à la dépendance financière et économique envers les instruments du capitalisme européen. Et l'action des ambassadeurs est désormais doublée de celle des hommes d'affaires.
1856 : Abdul Aziz signe en février un firman qui reprend les thèmes de la charte de Gul-Hané. En avril, le traité de Paris, qui marque la fin de la guerre de Crimée (durant laquelle la France et l'Angleterre ont soutenu la Turquie contre la Russie), reconnaît « la Sublime Porte admise à participer aux avantages du droit public et
du concert européens. » (Article 7)
La politique des réformes, même si elles n'entraînent pas une transformation réelle des conditions de vie des populations, a donc abouti à une garantie internationale de l'existence de l'Empire.
Quelles que soient les mutilations territoriales qu'il aura encore à subir, il n'est plus question de sa disparition.1868 : Une loi concède aux étrangers le droit à la propriété immobilière dans l'Empire. S'ajoutant aux immunités qui résultent des anciennes Capitulations toujours en vigueur, cette loi marque une étape nouvelle dans le processus de colonisation économique de l'Empire : il a sauvé son indépendance, mais la pénétration européenne continue.
Et la protection des populations chrétiennes n'est plus qu'un prétexte dans une politique d'intervention axée sur la seule recherche du profit.1877-1878 : Guerre russo-turque, la troisième en cinquante ans. Sur le front du Caucase, la Russie cherche une nouvelle fois à obtenir des avantages territoriaux auxquels les autres Puissances l'ont obligée à renoncer en 1829 et 1856.
Arménie 1915, un génocide exemplaire, Flammarion, Paris 1975
édition de poche, Marabout, 1978